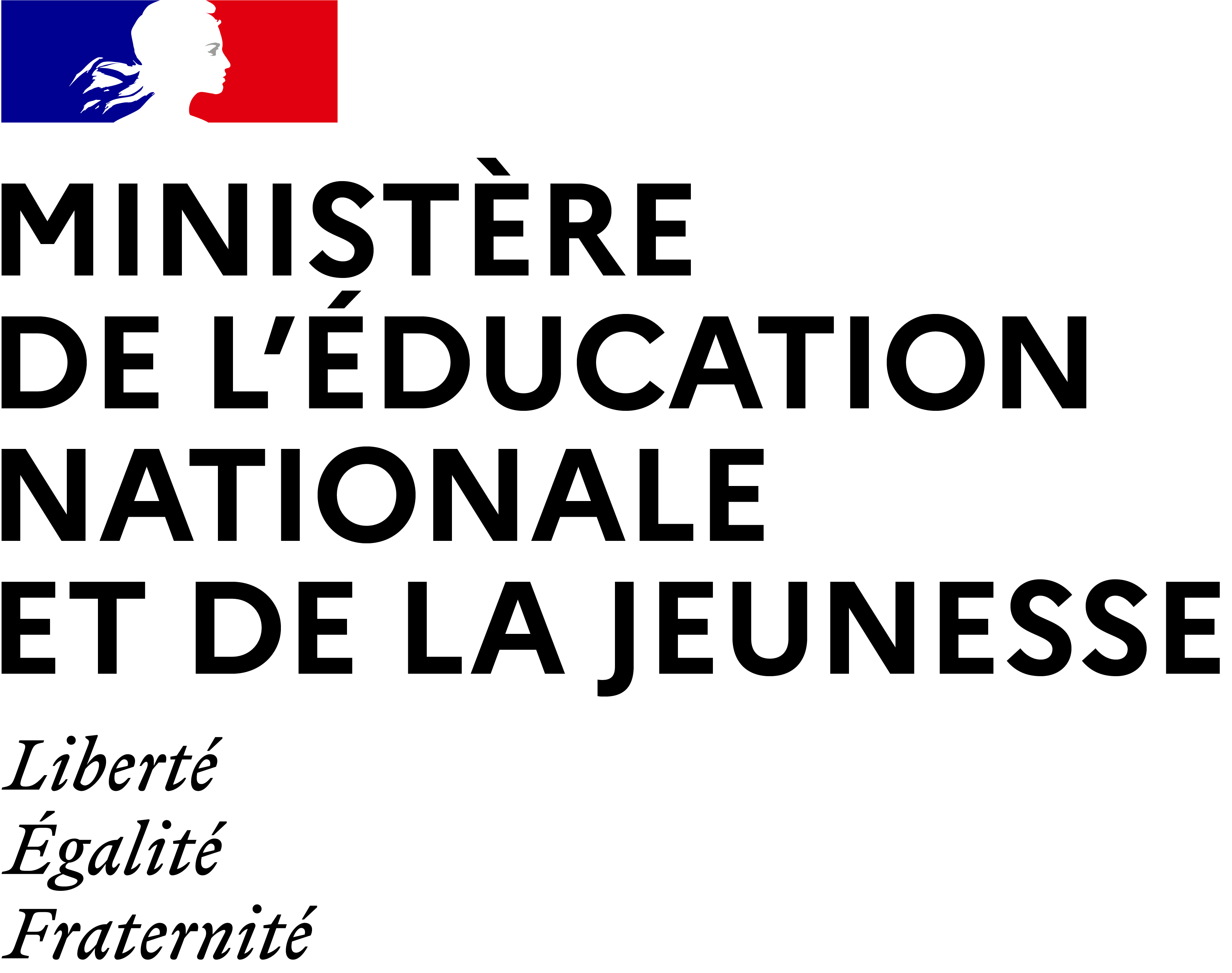Un Choc des savoirs pour élever le niveau de l'école et des élèves
Refonte des programmes, manuels scolaires, redoublement, groupes de niveaux, bac, brevet, etc. : les mesures qui seront mises en place pour élever le niveau des élèves à l'école, au collège et au lycée.
Découvrez toutes les mesures du "Choc des savoirs" présenté le 5 décembre 2023
Découvrez les diplômes
Diplôme national du brevet (DNB)
Le diplôme national du brevet évalue les connaissances et les compétences acquises à la fin du collège. Il est équilibré entre évaluation du socle (contrôle continu) et épreuves finales. Chaque discipline évaluée fait l'objet d'une épreuve distincte, sauf en sciences (deux disciplines), et d'une épreuve orale pour les candidats scolaires.
Certificat d'aptitude professionnelle (CAP)
Le CAP donne une qualification d'ouvrier ou d'employé qualifié dans un métier déterminé. Il existe environ 200 spécialités de CAP dans les secteurs industriels, commerciaux et des services.
Baccalauréat général
Le baccalauréat général repose pour une part sur un contrôle continu et pour une autre part sur des épreuves terminales.
Baccalauréat technologique
Le baccalauréat technologique associe culture générale et technologique. Il se prépare en deux ou en trois ans dans un lycée après une classe de seconde générale et technologique.
Le saviez-vous ?
Les candidats aux examens reçoivent leur convocation environ trois semaines avant le début des épreuves. Le centre d'examens et le matériel autorisé y sont précisés. Lors de l'examen, le candidat présente sa convocation et une pièce d'identité en cours de validité avec sa photographie.
Une session de remplacement est organisée et réservée aux candidats inscrits qui n'ont pu se présenter à la session normale pour des raisons dûment justifiées.
Comment obtenir la copie d'un diplôme ?
Rendez-vous sur diplome.gouv.fr
Diplome.gouv.fr délivre des attestations numériques certifiées de diplômes et permet également à des tiers de vérifier l'authenticité d'un diplôme grâce à une clé de contrôle fournie par le diplômé. Les bacheliers de l'édition 2019 peuvent y retrouver leur attestation numérique certifiée de diplôme.
Quels sont les examens internationaux ?
Abibac
L'Abibac offre un double avantage : la délivrance simultanée du baccalauréat français et de l'Abitur. Il est préparé dans les sections binationales "Abibac".
Esabac
L'Esabac permet la délivrance simultanée du baccalauréat français et de l'Esame di Stato italien. Ce diplôme est préparé dans les lycées à section binationale français / italien "Esabac". Les élèves qui l'obtiennent peuvent accéder à l'enseignement supérieur français ou italien.
Bachibac
Le bachibac permet la délivrance simultanée du baccalauréat français et du bachillerato espagnol. Ce diplôme est préparé dans les lycées à section binationale français / espagnol "bachibac". Les élèves qui l'obtiennent peuvent accéder à l'enseignement supérieur français ou espagnol.
Baccalauréat franco-allemand
Le baccalauréat franco-allemand repose sur des programmes, une organisation et des modalités d'évaluation spécifiques. Il donne tous les droits attachés au baccalauréat français et à l'Abitur allemand.
Le baccalauréat Français international (BFI)
Le baccalauréat Français international (BFI) s’inscrit dans la continuité des parcours en sections internationales du CP à la classe de 2de. Les élèves de classe de première de la voie générale qui s’engagent dans ce dispositif préparent pendant leurs deux années du cycle terminal cette nouvelle option internationale prise en compte à l’examen, à compter de la session 2024 du baccalauréat.