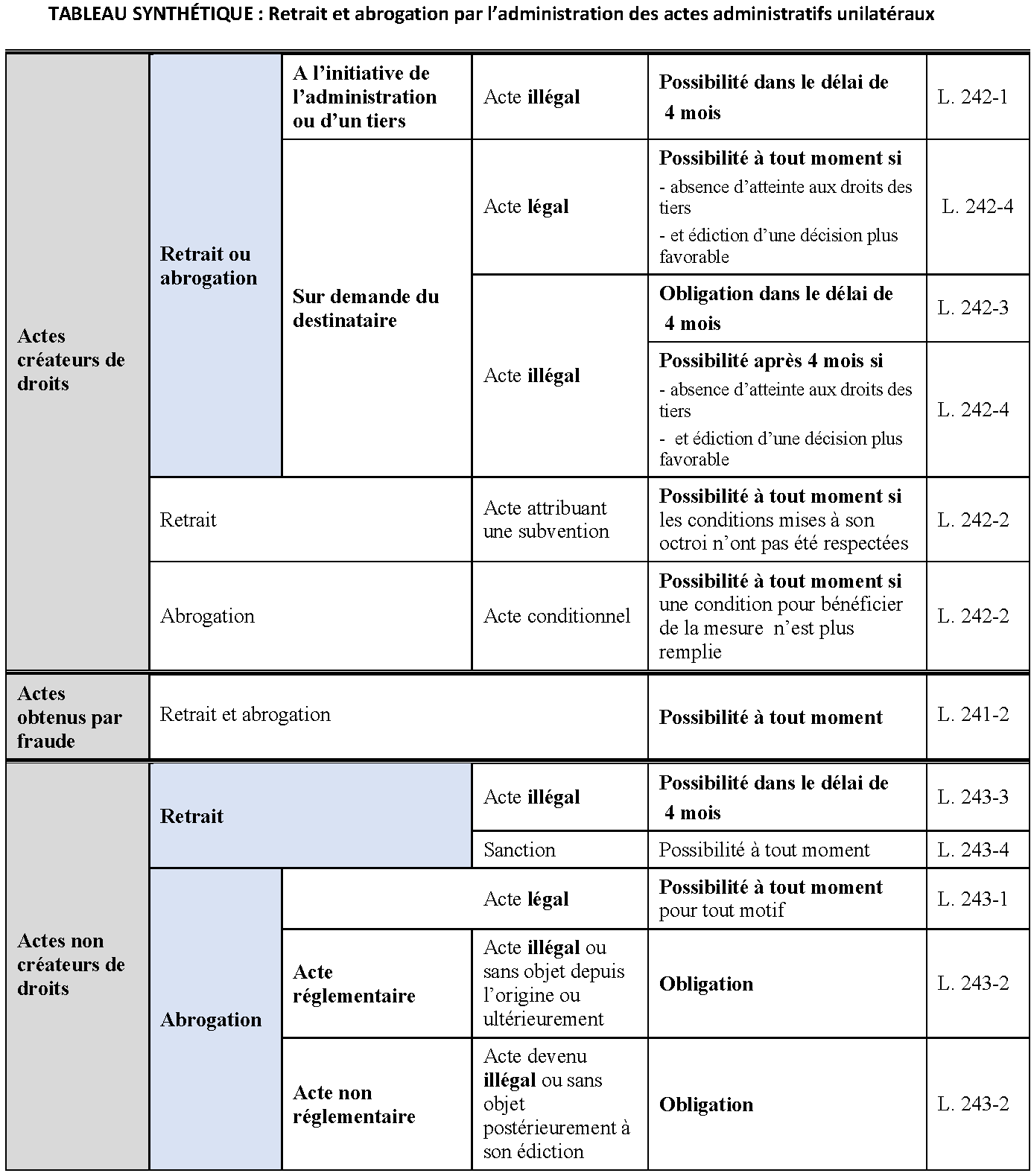| |
Enseignement scolaire
SECOND DEGRÉ
Scolarité
ORIENTATION DES ÉLÈVES
 Redoublement – Caractère exceptionnel – Conditions – Période importante de rupture des apprentissages scolaires et accord des représentants légaux Redoublement – Caractère exceptionnel – Conditions – Période importante de rupture des apprentissages scolaires et accord des représentants légaux
T.A. Toulouse, 21 mars 2017, n° 1602994
Les parents d’un élève de troisième demandaient au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision par laquelle la commission d’appel prévue par l’article D. 331-35 du code de l’éducation avait confirmé la décision du chef d’établissement du collège dans laquelle l’élève était scolarisé refusant, après que le conseil de classe se fut prononcé, le passage de leur fils en classe de seconde.
Le tribunal administratif de Toulouse a rappelé que, conformément aux dispositions de l’article D. 331-62 du code de l’éducation, le redoublement d’un élève, qui ne peut être mis en œuvre qu’à titre exceptionnel, est soumis à deux conditions cumulatives : il ne peut être autorisé que pour pallier une période importante de rupture des apprentissages scolaires et est subordonné à l’accord écrit des représentants légaux de l’élève mineur.
En l’espèce, la décision de redoublement se fondait sur l’insuffisance du niveau scolaire de l’élève et sur ses handicaps (celui-ci ayant été diagnostiqué dyslexique et dyspraxique). Le tribunal a relevé que de tels motifs ne constituaient pas une période importante de rupture des apprentissages scolaires qu’il conviendrait de pallier au sens de l’article D. 331-62. Il a constaté, en outre, que les parents de l’élève n’avaient pas donné leur accord au redoublement.
Le tribunal administratif de Toulouse a, par conséquent, annulé la décision attaquée.
N.B. : Le principe du caractère exceptionnel du redoublement résulte de l'article L. 311-7 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l’article 37 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République. L’article D. 331-62 du code de l’éducation, pris pour l’application de cette disposition législative, prévoit deux conditions qui sont cumulatives (sur la légalité de cet article, cf. C.E., 7 avril 2016, Syndicat national des lycées et collèges – SNALC, n° 387271, LIJ n° 194).
Ce jugement est également l’occasion de rappeler que les dispositions du code de l’éducation instituent un recours préalable obligatoire contre la décision d’orientation prise par le chef d’établissement, devant la commission d’appel prévue à l’article D. 331-35 du code de l’éducation. La décision d’orientation définitive prise par cette commission se substitue ainsi à la décision d’orientation prise par le chef d’établissement, laquelle ne peut pas être directement contestée devant le juge de l’excès de pouvoir. En l’espèce, les conclusions dirigées contre cette décision ont donc été rejetées comme irrecevables et le tribunal s’est borné à examiner la légalité de la seule décision prise par la commission d’appel. 
Enseignement supérieur et recherche
ORGANISATION NATIONALE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
 CNESER – Élections – Représentants des personnels CNESER – Élections – Représentants des personnels
C.E., 20 mars 2017, Confédération des jeunes chercheurs et M. X, n° 393756, aux tables du Recueil Lebon
La Confédération des jeunes chercheurs avait déposé au mois de septembre 2015 une requête en annulation des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 24 mars 2015 fixant les modalités d’élection au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) des représentants des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des représentants des personnels des établissements publics de recherche. L’article 2 de cet arrêté avait pour objet de fixer les conditions d’établissement et de publication des listes électorales en vue de l’organisation des élections prévues le 28 mai 2015.
Le Conseil d’État a déclaré la requête irrecevable au motif qu’elle avait été introduite après la proclamation des résultats du scrutin, effectuée le 11 juin 2015, alors qu’elle portait sur des dispositions ne revêtant pas « un caractère permanent ».
N.B. : Cette décision est à rapprocher de la décision du 24 avril 2012 (n° 352306, aux tables du Recueil Lebon) par laquelle le Conseil d’État a considéré que les dispositions de la circulaire n° 2011-107 du 18 juillet 2011 (relative à l'organisation des élections professionnelles – du 13 au 20 octobre 2011 – aux comités techniques et aux commissions administratives paritaires du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche) qui précisaient que « les agents affectés dans les établissements publics sous tutelle du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche (…) ne sont ni électeurs ni éligibles au comité technique du ministère de l'éducation nationale, mais le sont à celui du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche », qui ont été « adoptées en vue seulement des élections professionnelles du 13 au 20 octobre 2011 aux différents comités techniques de ces ministères », ne présentaient donc « pas un caractère permanent » et n’étaient « pas détachables de ces opérations électorales ».
Le Conseil d’État a par conséquent jugé que ces dispositions contestées de la circulaire du 18 juillet 2011 n’étaient pas « susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir » et ne pouvaient « être contestées qu’à l’occasion de recours formés contre les opérations électorales devant le juge de l’élection ». 
VIE ÉTUDIANTE
Bourses d’études et autres aides
 Remboursement d’un prêt d’honneur – Contestation d’un titre de perception – Mention obligatoire du caractère obligatoire de la réclamation préalable à la saisine du juge – Point de départ du délai pour adresser la réclamation préalable – Conditions de validité d’un titre de perception – Mention obligatoire du nom et du prénom de l’auteur du titre Remboursement d’un prêt d’honneur – Contestation d’un titre de perception – Mention obligatoire du caractère obligatoire de la réclamation préalable à la saisine du juge – Point de départ du délai pour adresser la réclamation préalable – Conditions de validité d’un titre de perception – Mention obligatoire du nom et du prénom de l’auteur du titre
C.A.A. Lyon, 23 février 2017, n° 15LY02649
La requérante avait obtenu d’un centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) un prêt d’honneur d’un montant de 20 000 francs (3 048,98 euros) qui devait être remboursé au plus tard dans la dixième année suivant l’obtention du prêt.
En l’absence de remboursement de ce prêt à l’issue de cette période, le recteur d’académie avait émis le 19 juillet 2011 un titre de perception. L’étudiante n’ayant respecté aucun des deux échéanciers qui lui avaient été accordés en décembre 2011 et en février 2014, le comptable public lui avait adressé, le 10 mars 2014, une mise en demeure de payer la somme de 2 808,98 euros restant due.
En première instance, le tribunal administratif avait rejeté pour irrecevabilité les conclusions à fin d’annulation de ce titre de perception et de cette mise en demeure, au motif que l’intéressée n’avait pas adressé une réclamation préalable dans les deux mois suivant la notification du titre de perception du 19 juillet 2011.
Saisie par l’étudiante, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement de première instance, en retenant « que le titre de perception ne mentionnait pas le caractère obligatoire du recours administratif préalable prévu par les dispositions [des articles 7 et 8 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'État mentionnées à l'article 80 de ce décret] ».
En outre, la cour a relevé « que [la requérante] a adressé une réclamation préalable au directeur départemental des finances publiques (…) le 12 mai 2014, dans le délai de deux mois suivant la notification, le 13 mars 2014, du premier acte de poursuite procédant du titre de perception contesté ; qu’une décision expresse de rejet de la réclamation (…) est intervenue le 1er juillet 2014 ; que, dès lors, les conclusions (…) présentées à fin d’annulation du titre de perception et enregistrées au greffe du tribunal administratif de Dijon le 1er septembre 2014 étaient recevables ».
Sur le fond, la cour a annulé le titre de perception du 19 juillet 2011 et, par voie de conséquence, la mise en demeure de payer du 10 mars 2014 au motif « que le titre de perception (…) ne comporte ni le nom ni le prénom de son auteur ; que s’il existe un état récapitulatif des créances comportant l’ensemble des mentions requises, il n’est pas allégué que ce document a été porté à la connaissance de la requérante en même temps que le titre de perception litigieux ; que, dans ces conditions, ledit titre ne peut être regardé comme comportant toutes les précisions nécessaires sur son auteur ».
N.B. : Les articles 118 et 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dont les dispositions ont repris celles des articles 7 et 8 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992, prévoient que : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; / (…) / L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. À défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée » et que : « Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118. »
Ces dispositions imposent donc l’exercice d’un recours administratif préalable dont le caractère obligatoire, ainsi que le rappelle la cour dans son arrêt, doit être mentionné sur le titre de perception ou sur la lettre qui le notifie pour que le délai de recours contentieux commence à courir (C.E., 4 juin 2008, n° 309400).
Ainsi qu’il ressort d’un précédent arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon (C.A.A. Lyon, 24 septembre 2013, Communauté de communes du Val de Drôme, n° 12LY02749), l’indication de la mention des voies et délais de recours, qui doit figurer sur le titre de perception ou sa notification, ne se confond pas avec l’indication du caractère obligatoire du recours administratif préalable devant le comptable public, que doit également comporter le titre de perception ou la lettre qui le notifie.
Ce défaut d’indication du caractère obligatoire du recours administratif préalable n’emporte de conséquences que sur le délai de recours contentieux, mais ne fait pas obstacle à ce qu’une requête puisse être déclarée irrecevable faute d’avoir été précédée d’un tel recours (cf. C.E., 4 juin 2008, n° 309400 mentionnée supra).
Tel n’était toutefois pas le cas en l’espèce puisque la requérante avait formé une réclamation préalable dans le délai de deux mois suivant la notification du premier acte de poursuite procédant du titre de perception, réclamation qui avait été expressément rejetée par décision du 1er juillet 2014, ainsi que l’a observé la cour qui a également relevé que le défaut de mention, sur le titre de perception ou sa notification, du caractère obligatoire du recours administratif préalable avait en tout état de cause conservé au bénéfice de la requérante la possibilité de former une réclamation, sans que la forclusion puisse lui être opposée.
Enfin, cet arrêt est l’occasion de rappeler qu’une décision doit comporter, ainsi que l’exige l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration (C.R.P.A.), « outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Si ces mentions n’ont pas à être présentes nécessairement sur le titre de perception lui-même et peuvent figurer, comme en l’espèce, sur un état récapitulatif des créances, encore faut-il, pour que les exigences de l’article L. 212-1 soient satisfaites, que ce document ait été porté à la connaissance de l’intéressé en même temps que le titre de perception, la preuve de cette transmission incombant à l’expéditeur.
De ce point de vue, l’arrêt de la cour peut être rapproché d’une décision n° 298049 du 19 mars 2008, mentionnée aux tables du Recueil Lebon, par laquelle le Conseil d’État avait relevé l’absence de signature sur le titre de perception et « qu’il n’était pas établi que le bordereau journalier portant la signature de l’autorité compétente, qui constitue le titre exécutoire auquel sont annexés les titres de perception individuels, ait été porté à la connaissance de l’intéressée en même temps que le titre de perception litigieux ». 
Examens et concours
QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTS EXAMENS ET CONCOURS
Baccalauréat
 Examen – Baccalauréat – Attribution d’une mention aux candidats obtenant leur diplôme après s’être présentés à plusieurs sessions de l’examen, mais non aux candidats ayant obtenu leur diplôme en une seule session après s’être présentés aux épreuves du second groupe – Atteinte au principe d’égalité (oui) Examen – Baccalauréat – Attribution d’une mention aux candidats obtenant leur diplôme après s’être présentés à plusieurs sessions de l’examen, mais non aux candidats ayant obtenu leur diplôme en une seule session après s’être présentés aux épreuves du second groupe – Atteinte au principe d’égalité (oui)
C.E., 31 mars 2017, Association S.O.S. Éducation, n° 395506, aux tables du Recueil Lebon
Afin de lutter contre le décrochage scolaire, le décret n° 2015-1351 du 26 octobre 2015 modifiant les dispositions du code de l’éducation relatives à la préparation aux examens des voies générale, professionnelle et technologique des lycées et à la délivrance du baccalauréat a prévu (cf. LIJ n° 191, janvier 2016) :
– d’une part, que tout élève ayant échoué à un examen des voies générale, professionnelle et technologique (baccalauréat, brevet de technicien, brevet de technicien supérieur ou certificat d’aptitude professionnelle) a le droit de bénéficier, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, d’une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est issu afin de préparer à nouveau cet examen, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et compétences qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen (articles 1er à 4) ;
– d’autre part, que tous les candidats au baccalauréat général et au baccalauréat technologique qui ont échoué à l’examen peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu’ils ont obtenues à ces épreuves lorsqu’ils se présentent à la même série du baccalauréat et dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en permettant que cette conservation de notes ne fasse plus obstacle, comme c’était le cas avant l’entrée en vigueur de ce décret du 26 octobre 2015, à l’attribution d’une mention au baccalauréat, en fonction de la moyenne des notes conservées et obtenues (articles 6 et 8).
Avant l’entrée en vigueur du décret d’octobre 2015, cette possibilité de conservation de notes était en effet réservée à certaines catégories particulières de candidats (candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d’emplois, sportifs de haut niveau ou scolarisés à l’école de danse de l’Opéra national de Paris) et ne permettait pas l’attribution d’une mention.
Saisi d’une requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret, le Conseil d’État en a partiellement prononcé l’annulation.
Il a d’abord jugé que les dispositions prévues par les articles 1 à 4 du décret ne méconnaissent pas le principe de continuité éducative posé par les dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'éducation quand bien même elles sont susceptibles de conduire, dans certaines situations, à ce que le candidat concerné soit dispensé de certains enseignements lorsqu’il suit sa seconde année de préparation à l’examen.
En revanche, le Conseil d’État a jugé qu’en prévoyant que peuvent obtenir une mention les candidats ayant obtenu leur diplôme de baccalauréat au terme de plusieurs sessions dans la même série, alors que les candidats obtenant leur baccalauréat en une seule session, mais après avoir dû se présenter au second groupe d'épreuves (dit « oraux de rattrapage ») ne peuvent prétendre à aucune mention, le décret attaqué a introduit entre ces deux catégories de candidats au baccalauréat une différence de traitement qui n'est pas justifiée par une différence de situation en rapport avec l'objet de cette réglementation. Il a précisé que si la faculté d'attribuer une mention aux candidats qui obtiennent leur baccalauréat en plusieurs sessions peut être justifiée par le motif d'intérêt général de lutte contre le décrochage scolaire, un tel motif n'est pas pour autant de nature à justifier cette différence de traitement dans l'attribution des mentions entre ces deux catégories de candidats.
Le Conseil d’État a, en conséquence, annulé les articles 6 et 8 du décret du 26 octobre 2015 « en tant qu’ils ne reprennent pas les derniers alinéas des articles D. 334-13 [baccalauréat général] et D. 336-13 [baccalauréat technologique] du code de l’éducation dans leurs rédactions antérieures à ce décret », lesquels prévoyaient qu’aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont bénéficié d’une conservation de notes.
Il a également annulé, par voie de conséquence, l’article 7 du décret du 26 octobre 2015 qui supprimait la référence à l’article D. 336-13 excluant, dans l’article D. 336-11 relatif aux mentions que peuvent porter les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique, l’attribution de mentions aux candidats à l’examen ayant bénéficié d’une conservation de notes.
Cette annulation prononcée par le Conseil d’État a eu pour effet de rétablir les derniers alinéas des articles D. 334-13 et D. 336-13 dans leur rédaction applicable avant l’entrée en vigueur du décret du 26 octobre 2015 (cf. ces articles du code dans Légifrance) : depuis la lecture de cette décision juridictionnelle, ces articles comportent donc à nouveau un dernier alinéa prévoyant que : « Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa du présent article. » Cette impossibilité d'accorder des mentions est ainsi applicable dès la session 2017 du baccalauréat aux candidats qui présentent l’examen du baccalauréat général ou technologique en ayant fait le choix de conserver des notes obtenues lors de sessions antérieures. 
Personnels
QUESTIONS COMMUNES
Instances représentatives
 Organisation syndicale représentative au niveau d’une académie – Accord national professionnel – Possibilité de siéger dans une instance non instituée par un accord collectif – Article 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 Organisation syndicale représentative au niveau d’une académie – Accord national professionnel – Possibilité de siéger dans une instance non instituée par un accord collectif – Article 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
Cass. soc., 18 janvier 2017, n° 15-20549, au Bulletin
Un accord national professionnel sur l'organisation de l'emploi des maîtres des établissements catholiques d'enseignement du second degré sous contrat d'association avait été conclu le 12 mars 1987 entre les chefs d'établissement, représentés par les organisations syndicales représentatives de la profession, les maîtres, représentés par les organisations nationales représentatives de droit ou dans la profession, et le secrétariat général de l'enseignement catholique.
Cet accord prévoit la création, dans chaque académie, d'une commission académique de l'emploi composée de représentants des maîtres et des chefs d'établissement, les représentants des maîtres disposant de neuf sièges, répartis entre les organisations syndicales représentatives de droit ou dans la profession au niveau national, et signataires de l'accord.
Le syndicat Sundep-Solidaires avait demandé à siéger au sein de la commission académique de Toulouse en faisant valoir sa représentativité dans cette académie. Devant le refus qui lui était opposé, le syndicat avait saisi la juridiction prud’homale.
La cour d’appel de Toulouse avait cependant rejeté sa demande aux motifs que l'accord de 1987 n'avait pas été signé entre l'État, employeur des maîtres, et les organisations syndicales de salariés et que la commission académique de l’emploi au sein de laquelle le syndicat requérant souhaitait siéger n’avait, par conséquent, pas été instituée par un accord collectif au sens du code du travail.
La cour avait également estimé qu’il résulte de l'article L. 442-5 du code de l'éducation que les dispositions du droit du travail ne s'appliquent qu'aux élections des délégués du personnel, aux élections au C.H.S.C.T. et au comité d'entreprise, et que les commissions administratives de l'emploi, qui n'ont pas été mises en place par la loi mais ont été créées par l'enseignement catholique, ne sont pas des institutions représentatives du personnel et n'ont pas vocation à être régies par le code du travail.
La Cour de cassation a toutefois cassé, au visa du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 qui dispose que : « Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises », l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse.
Elle a en effet jugé que, quelle que soit sa qualification, un accord national conclu entre les maîtres et les chefs d'établissement des établissements catholiques de l'enseignement du second degré qui institue dans chaque académie des commissions disposant de prérogatives dans l'organisation du mouvement annuel du personnel, composées de représentants désignés par les organisations syndicales en fonction de leur représentativité, ne peut priver une organisation syndicale représentative dans une académie de la possibilité de siéger dans la commission académique.
Elle a par conséquent considéré que la cour d’appel, qui avait constaté, d’une part, que les commissions académiques de l’emploi préparaient, dans chaque académie, les projets de mouvements des maîtres et, d’autre part, que le syndicat Sundep-Solidaires était représentatif au niveau de l’académie de Toulouse, ne pouvait en l’espèce refuser à ce syndicat la possibilité de siéger au sein de la commission académique sans violer le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 susmentionné. 
Positions
DISPONIBILITÉ
 Fonctionnaire – Disponibilité – Réintégration – Allocation pour perte d’emploi Fonctionnaire – Disponibilité – Réintégration – Allocation pour perte d’emploi
C.E., 27 janvier 2017, n° 392860, aux tables du Recueil Lebon
Une attachée d’administration du ministère de l’agriculture placée en disponibilité pour suivre son conjoint avait sollicité sa réintégration le 28 septembre 2012, soit deux jours avant la fin de sa période de disponibilité fixée au 30 septembre 2012. En l’absence de poste disponible, elle avait été placée en disponibilité d’office. Elle avait sollicité, le 20 décembre 2012, le versement de l’allocation pour perte d’emploi à titre rétroactif à compter du 1er octobre 2012, date de sa mise en disponibilité d’office. Elle avait ensuite saisi le tribunal administratif d’une demande d’annulation de la décision implicite de refus opposée à sa demande.
Le tribunal avait rejeté ses conclusions. Par un arrêt n° 14NC00857 du 18 juin 2015, la cour administrative d’appel avait annulé le jugement ainsi que la décision implicite de refus opposée par l’administration à sa demande de versement de l’allocation pour perte d’emploi et avait enjoint à l’État de lui verser cette allocation pour perte d’emploi avec effet rétroactif.
Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’État a cassé l’arrêt de la cour administrative d’appel pour erreur de droit et lui a renvoyé l’affaire.
L’article L. 5424-1 du code du travail permet aux fonctionnaires de bénéficier d’une allocation d’assurance chômage s’ils remplissent cumulativement les conditions d’avoir été involontairement privés d’emploi et d’être à la recherche d’un emploi, posées par l’article L. 5421-1 du même code.
Pour sa part, le troisième alinéa de l’article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions impose aux fonctionnaires en disponibilité de faire connaître à leur administration d’origine leur décision d’en solliciter le renouvellement ou de réintégrer leur corps d’origine trois mois avant l’expiration de la disponibilité.
Le Conseil d’État a rappelé qu’un fonctionnaire en disponibilité qui a fait sa demande de réintégration dans les délais prescrits, mais qui n’a pu obtenir satisfaction faute de poste vacant « doit, en principe, être regardé comme ayant été non seulement involontairement privé d'emploi, mais aussi à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5421-1 du code du travail, au titre de la période comprise entre la date à laquelle sa mise en disponibilité a expiré et la date de sa réintégration à la première vacance [et] (…) peut prétendre au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ».
Il a ensuite considéré qu’« un fonctionnaire qui, en méconnaissance des obligations s'imposant à lui du fait des dispositions précitées de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985, n'a présenté à son administration sa demande de réintégration au sein de son corps d'origine que moins de trois mois avant l'expiration de sa période de mise en disponibilité ne saurait être regardé comme involontairement privé d'emploi dès l'expiration de cette période. Dans un tel cas, il n'est réputé involontairement privé d'emploi et, dès lors, ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi, avant qu'un délai de trois mois ne se soit écoulé depuis sa demande de réintégration. Des démarches accomplies par le fonctionnaire tendant à identifier des postes susceptibles de lui convenir lors de sa réintégration ultérieure ou l'expression par cet agent de simples souhaits de reprise des fonctions ne sauraient à cet égard tenir lieu de demande expresse de réintégration ni produire les mêmes effets qu'elle ».
La requérante ayant déposé sa demande de réintégration le 28 septembre 2012, soit deux jours avant l’expiration de sa disponibilité, elle ne pouvait donc être regardée comme involontairement privée d’emploi pour la période du 1er octobre au 28 décembre 2012.
N.B. : L’article L. 351-12 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, permettait aux agents titulaires appartenant à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière de bénéficier des allocations d’assurance chômage en cas de perte involontaire d’emploi. L’article 62 de la loi du 2 février 2007 a complété l’article L. 351-12 pour permettre aux fonctionnaires de l’État d’en bénéficier également. Cette disposition législative est aujourd’hui codifiée à l’article L. 5424-1 du code du travail.
Le juge administratif a admis que les fonctionnaires qui sollicitent leur réintégration à l’issue d’une période de disponibilité mais qui ne l’obtiennent pas faute de poste vacant doivent être regardés comme involontairement privés d’emploi et à la recherche d’un emploi au sens de l’article L. 5421-1 du code du travail, pour la période allant de la fin de la disponibilité à la réintégration à la première vacance (cf. C.E., 30 septembre 2002, n° 216912, aux tables du Recueil Lebon, pour un fonctionnaire hospitalier, et C.E., 28 juillet 2004, Office public d’aménagement et de construction Sarthe Habitat, n° 243387, aux tables du Recueil Lebon, pour un fonctionnaire territorial).
Le juge considère également que l’allocation d’assurance pour perte involontaire d’emploi ne peut être versée à un fonctionnaire maintenu en disponibilité d’office à l’issue d’une période de disponibilité sur demande que si ce maintien en disponibilité résulte de motifs indépendants de sa volonté (C.E., 24 février 2016, Région Poitou-Charentes, n° 380116, aux tables du Recueil Lebon). Ce qui n’est pas le cas si l’agent « a refusé un emploi répondant aux conditions définies par les dispositions statutaires lui étant applicables qui lui a été proposé par la collectivité en vue de sa réintégration ».
La décision du 27 janvier 2017 vient préciser les modalités de prise en compte de la méconnaissance par le fonctionnaire du délai de préavis prévu par les dispositions réglementaires relatives à la réintégration à l’issue de la disponibilité (article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 pour la fonction publique d’État, article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 pour la fonction publique territoriale, fixant le délai à trois mois avant l’expiration de la période de disponibilité, et article 37 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 pour la fonction publique hospitalière, fixant ce délai à deux mois).
L’objet de ce délai d’information de l’administration employeur étant de permettre à cette dernière d’organiser le retour du fonctionnaire placé en disponibilité, sa méconnaissance implique le maintien du fonctionnaire en disponibilité d’office, maintien qui ne peut dans ces conditions être regardé comme indépendant de la volonté du fonctionnaire et a par conséquent des incidences sur le droit au bénéfice de l’allocation pour perte d’emploi dont le versement ne pourra débuter qu’à l’expiration du délai réglementaire de trois mois ou, pour la fonction publique hospitalière, de deux mois après la date de la demande de réintégration. 
Évaluation – Notation
 Professeur certifié détaché dans un établissement d’enseignement supérieur – Notation – Proposition du chef d’établissement – Acte préparatoire insusceptible de recours Professeur certifié détaché dans un établissement d’enseignement supérieur – Notation – Proposition du chef d’établissement – Acte préparatoire insusceptible de recours
C.A.A. Paris, 13 décembre 2016, n° 15PA00746
Un professeur certifié avait été détaché pour exercer des fonctions au sein d’un institut universitaire de formation des maîtres (I.U.F.M.), école interne à une université. La directrice de cette école avait proposé d’attribuer à cet enseignant une note de 87 sur 100 assortie d’appréciations défavorables. Sur requête de l’intéressé, et après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente, le ministre avait réévalué cette note à 90 sur 100. Les appréciations de la directrice de l’établissement étaient demeurées, quant à elles, inchangées.
La cour administrative d’appel était saisie par l’université d’une demande d’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif avait annulé la notation de l’enseignant et enjoint à l’université de procéder à une nouvelle notation.
La cour a tout d’abord rappelé les dispositions de l’article 31 du décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés selon lesquelles « la notation (…) des personnels détachés pour exercer dans un établissement d’enseignement supérieur comporte une note unique de 0 à 100, arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions ».
Puis la cour a jugé « qu’il résulte de ces dispositions que seul le ministre a compétence pour procéder à la notation des professeurs certifiés (…) détachés pour exercer dans un établissement d’enseignement supérieur ; que (…) l’autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions (…) n’a qu’un pouvoir de proposition ; que, dès lors, la notice annuelle de notation (…) émise par celle-ci revêt le caractère d’un acte préparatoire insusceptible de recours ».
Or, ainsi que l’a observé la cour, l’enseignant avait demandé au tribunal administratif d’annuler la seule notice de notation établie par la directrice de l’I.U.F.M., son établissement d’affectation, « sans jamais présenter de conclusions à l’encontre de la notation émise par le ministre, seule susceptible de recours ».
La cour a donc annulé le jugement du tribunal qui aurait dû rejeter pour irrecevabilité les conclusions dirigées contre la notice annuelle de notation établie par la directrice de l’I.U.F.M.
N.B. : À la différence des personnels enseignants affectés dans l’enseignement secondaire dont la note de 0 à 100 se décompose en une note administrative de 0 à 40 et une note pédagogique de 0 à 60, les personnels qui exercent dans un établissement d’enseignement supérieur font l’objet d’une note unique de 0 à 100 arrêtée par le ministre compte tenu des notes et appréciations portées par le président ou directeur de cet établissement d’enseignement supérieur qui, ainsi que le rappelle la cour dans l’arrêt commenté, ne fait que proposer une note au ministre, seul compétent pour arrêter la note définitive de l’enseignant.
En jugeant irrecevables des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la proposition de note faite au ministre par le directeur de l’établissement d’enseignement supérieur au motif qu’elle revêt le caractère d’un acte préparatoire insusceptible de recours, l’arrêt de la cour peut être rapproché des décisions par lesquelles le Conseil d’État a jugé, au sujet des militaires qui font l’objet d’une notation à plusieurs degrés, que seule la note définitive arrêtée par le dernier notateur fait grief et que les notes antérieures doivent être regardées comme des mesures préparatoires insusceptibles de recours (C.E., 19 mars 1997, n° 168656, aux tables du Recueil Lebon ; C.E., 8 juillet 2005, n° 262417, aux tables du Recueil Lebon). 
Obligations des fonctionnaires
DEVOIR DE RÉSERVE
 Personnel enseignant – Discipline – Manquements à l’obligation de réserve – Déplacement d’office Personnel enseignant – Discipline – Manquements à l’obligation de réserve – Déplacement d’office
C.A.A. Bordeaux, 24 janvier 2017, n° 15BX00543 et n° 15BX00544
Les requérants, professeurs d’éducation physique et sportive, avaient obtenu devant le tribunal administratif de Pau l’annulation, prononcée pour un motif de légalité externe, de l’arrêté par lequel le recteur de l’académie de Bordeaux avait prononcé à leur encontre la sanction du déplacement d’office. Ils demandaient à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler les jugements rendus en tant qu’ils ne faisaient pas droit à leurs conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de les réaffecter au collège dans lequel ils exerçaient précédemment leurs fonctions et de condamner l’État à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’ils estimaient avoir subi.
La cour a rejeté les deux requêtes.
Elle a d’abord rappelé que si les décisions rectorales de déplacement d’office avaient fait l’objet d’une annulation par le tribunal administratif de Pau pour un motif de légalité externe, cette illégalité ne pouvait toutefois être de nature à engager la responsabilité de l’État s’il résultait de l’instruction que ces sanctions, si elles avaient été prises dans le respect de la procédure applicable, auraient été justifiées par les faits reprochés aux intéressés.
Elle a ensuite relevé que pour prononcer les sanctions contestées, l’administration s’était fondée sur « les positionnements professionnels de[s] l’intéressé[s] qui ont porté atteinte à l’image du service public de l’éducation nationale » et sur « des manquements répétés à l’obligation de réserve des fonctionnaires ».
Elle a également relevé que les requérants soutenaient qu’ils avaient simplement usé de leur devoir de signalement dans l’intérêt des enfants face à des faits d’une exceptionnelle gravité concernant l’un de leur collègues enseignants qui manifestait envers les élèves un comportement fait de « brimades, humiliations et violences physiques ».
Elle a retenu que les requérants revendiquaient avoir participé en tant que simples citoyens à la réunion plénière du collectif des parents, à l’occasion de laquelle avait été sérieusement mise en cause la communauté éducative, et s’être entretenus avec un journaliste devant l’établissement dans un climat de tension extrême, et elle a estimé que, par leur simple présence à cette réunion, ils avaient cautionné les accusations qui avaient jeté le discrédit sur leurs collègues, sur l’équipe de direction et sur l’établissement scolaire, et généré des troubles ayant conduit au blocus de cet établissement.
La cour a par ailleurs relevé qu’il était avéré qu’en acceptant de répondre à une interview par voie de presse sans y avoir été autorisés par la hiérarchie, en faisant état publiquement du différend professionnel qui les opposait à la direction de l’établissement scolaire, les requérants avaient manqué au devoir de réserve qui s’impose à tout agent public.
Elle a enfin estimé que si les requérants soutenaient que leurs agissements étaient justifiés par des faits graves imputables à certains de leurs collègues vis-à-vis d’élèves, à supposer que ces faits aient été exacts, il ne ressortait pas des pièces du dossier qu’ils n’auraient eu aucun autre moyen que ceux qu’ils avaient employés pour signaler les agissements qu’ils dénonçaient, de façon à ce que la protection des élèves soit assurée.
Dans ces conditions, la cour a jugé que les manquements reprochés aux requérants, ainsi que leur caractère répété dans un climat conflictuel engageant des élèves de l’établissement, en particulier, les propos tenus ayant fait l’objet d’une large diffusion à l’extérieur du service, compte tenu des fonctions d’enseignant exercées par les intéressés et de leurs responsabilités auprès des élèves, avaient été de nature à porter atteinte à l’image du service public de l’éducation et présentaient un caractère de gravité suffisant pour justifier une sanction disciplinaire et que la sanction du deuxième groupe de déplacement d’office prononcée par le recteur de l’académie de Bordeaux à raison de ces faits n’était pas disproportionnée.
Par ailleurs, la cour a considéré que le recteur, en sanctionnant un manquement à l’obligation de réserve, n’avait pas porté atteinte à la liberté d’opinion des requérants, garantie notamment par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Elle a jugé que les requérants n’étaient, en conséquence, pas fondés à soutenir que la responsabilité de l’État était engagée à raison de l’illégalité fautive entachant les décisions prononçant leur déplacement d’office, ni, par suite, que c’était à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif avait rejeté leurs conclusions à fin d’indemnisation et d’injonction.
N.B. : L’obligation de réserve contraint les agents publics à observer une retenue dans l’expression écrite et orale de leurs opinions personnelles et à éviter en toutes circonstances les comportements susceptibles de porter atteinte à la considération du service public par les usagers. Cette construction jurisprudentielle (cf. C.E. Section, 11 janvier 1935, Sieur Bouzanquet, n° 40842, au Recueil Lebon) qui ne figure pas expressément dans les lois statutaires relatives à la fonction publique est appréciée par le juge en fonction de chaque situation, comme l’illustrent ces arrêts.
Elle s’applique ainsi avec une rigueur qui dépend de la position hiérarchique de l’agent concerné, des circonstances dans lesquelles il s'est exprimé (cf. C.E., 18 mai 1956, Sieur Boddaert, n° 15589, au Recueil Lebon, pour une atténuation de l’intensité de l’obligation dans le cadre de l’exercice d’un mandat syndical), de la publicité donnée à ses propos et des formes de l'expression. L’obligation de réserve ne concerne pas le contenu des opinions, la liberté d’opinion étant reconnue aux agents par l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, mais leur mode d’expression.
À noter également l’application faite par la cour de la jurisprudence selon laquelle en l’absence de lien de causalité entre le préjudice subi et le vice entachant la décision, la demande d’indemnité formulée à ce titre doit être rejetée (cf. C.E. Section, 19 juin 1981, n° 20619, au Recueil Lebon, et C.E., 7 juin 2010, n° 312909, aux tables du Recueil Lebon), rappelant ainsi, s’agissant d’un vice de procédure, que si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de la collectivité publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d’une procédure régulière, la même décision aurait pu être prise. 
Droits et garanties
AUTORISATION D’ABSENCE
 Personnel – Autorisation d’absence facultative – Nécessités de service Personnel – Autorisation d’absence facultative – Nécessités de service
T.A. Nîmes, 9 mars 2017, n° 1500343
La requérante, professeure des écoles, demandait au tribunal administratif d’annuler une décision du 22 décembre 2014 de l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN), qui refusait de l’autoriser à s’absenter pour une durée de cinq jours pour se présenter aux examens du diplôme de licence d’histoire de l’art qu’elle préparait, et de condamner l’administration au remboursement de la somme de 149 euros correspondant aux frais qu’elle avait engagés. Elle soutenait que ses études d’histoire de l’art s’inscrivaient dans le cadre du droit à la formation et que le refus qui lui avait été opposé entravait toute reconversion professionnelle.
Le tribunal administratif a rejeté la requête.
Le tribunal a d’abord constaté que la formation suivie par la requérante n’était pas organisée dans le cadre de son activité professionnelle, mais à titre personnel dans une perspective de reconversion.
Il a ensuite rappelé que les autorisations d’absence du service pour des motifs personnels ne sont pas de droit et ne peuvent être accordées que sous réserve des nécessités du service.
Ainsi, le tribunal a jugé que la période d’examen pour laquelle la requérante avait demandé une autorisation d’absence correspondait à une semaine de rentrée après les vacances scolaires et que le directeur académique des services de l’éducation nationale avait pu, à bon droit, considérer qu’une priorité devait être donnée au service de l’enseignante en présence des élèves.
N.B. : Par ce jugement, le tribunal rappelle que les autorisations d’absences facultatives demandées pour un motif personnel ne sont pas de droit et doivent être compatibles avec l’intérêt du service.
Au cas particulier des autorisations d’absence pour suivre une formation, le juge apprécie si la formation pour laquelle le fonctionnaire sollicite une autorisation d’absence est en rapport ou non avec sa situation professionnelle.
En l’espèce, la demande de la requérante de bénéficier d’une autorisation d’absence pour se présenter à des examens universitaires pendant une durée de cinq jours constituait une demande individuelle ne relevant pas des dispositions législatives et réglementaires relatives à la formation tout au long de la vie.
Il convient en effet de distinguer les autorisations d’absence pour suivre une formation à titre personnel des congés de formation prévus par le 6° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et régis par les articles 24 à 30 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’État.
En effet, les fonctionnaires peuvent bénéficier d’un congé de formation d’une durée maximum d’un an en vue d’étendre ou de parfaire leur formation personnelle.
En revanche, le droit individuel à la formation, que prévoyait l’article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires avant sa modification par l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, dont les conditions d’octroi étaient précisées par les articles 10 à 14 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007, ne peut être utilisé pour une formation sans rapport avec la situation professionnelle du fonctionnaire (cf. C.E., 22 juillet 2016, n° 397345, aux tables du Recueil Lebon, LIJ n° 195, novembre 2016).
En ce qui concerne le droit individuel à la formation, il convient de signaler que l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 l’a abrogé et remplacé par le compte personnel de formation (cf. articles 22 et 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 19 janvier 2017) et que les dispositions du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 traitant du DIF seront donc prochainement abrogées (cf. signalement de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 dans la rubrique « Actualités » de la présente LIJ). 
Rémunérations, traitement et avantages en nature
CONCESSION DE LOGEMENT
 Concession de logement par nécessité absolue de service – Gestionnaire matériel d’un établissement public local d’enseignement – Demande de dérogation à l’obligation de résidence sur le lieu d’affectation (refus) Concession de logement par nécessité absolue de service – Gestionnaire matériel d’un établissement public local d’enseignement – Demande de dérogation à l’obligation de résidence sur le lieu d’affectation (refus)
C.A.A. Marseille, 31 janvier 2017, n° 15MA00986
Une attachée principale d’administration de l’État affectée en qualité de gestionnaire matériel d’un établissement public local d’enseignement (E.P.L.E.) avait demandé l’annulation de la décision du 7 septembre 2012 par laquelle le recteur de l’académie de Nice avait rejeté sa demande de dérogation à son obligation de résidence sur son lieu d’affectation pour l’année scolaire 2012-2013.
Par un jugement du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulon avait rejeté cette demande. L’intéressée avait interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Marseille.
La cour a d’abord rappelé qu’il résulte des dispositions des articles R. 216-4, R. 216-5 et R. 216-17 du code de l’éducation qu’il appartient à l’organe délibérant de la collectivité territoriale de rattachement de l’E.P.L.E. d’arrêter la liste des emplois dont les titulaires bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service.
Elle a ensuite précisé que les concessions de logement par nécessité absolue de service sont accordées aux personnels de direction, d’administration, de gestion et d’éducation, ainsi que le prévoit l’article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques (qui a repris la substance de l’article R. 94 du code du domaine de l’État), lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate.
La cour en a déduit qu’il ne peut être dérogé à l’obligation de résidence par nécessité absolue de service « qu’à titre exceptionnel », lorsque la situation personnelle de l’agent le justifie et que la dérogation n’est pas de nature à compromettre la bonne marche du service au regard des responsabilités de cet agent et des sujétions liées aux fonctions qu’il exerce.
La cour a relevé que les fonctions de gestionnaire matériel exercées par la requérante étaient au nombre des fonctions d’administration et de gestion au sens de l’article R. 216-5 du code de l’éducation et que cet emploi figurait sur la liste des emplois arrêtée par l’organe délibérant de la collectivité territoriale de rattachement de l’E.P.L.E. dont les titulaires bénéficient d’une concession par nécessité absolue de service. Elle en a conclu que l’obligation faite à la requérante de résider sur son lieu de travail répondait directement à « un impératif de bonne marche du service ».
La cour a enfin écarté les arguments par lesquels la requérante soutenait que sa situation personnelle justifiait qu’il soit fait droit à sa demande de dérogation. Après avoir relevé que l’obligation de résidence sur son lieu d’affectation ne portait pas atteinte de façon disproportionnée à la vie commune de son couple, la cour a indiqué que rien ne faisait obstacle à ce que son compagnon mène avec elle une vie commune au sein de ce logement de fonction tout en poursuivant ses activités professionnelles de gérant de sociétés commerciales à l’adresse de leur logement personnel.
La cour administrative d’appel de Marseille a donc rejeté la requête.
N.B. : Le bénéfice d’un logement de fonction est accordé dans l’intérêt du service et non en fonction des convenances personnelles de l’agent (cf. C.E., 21 avril 1950, Sieur Hoffert, n° 97339, au Recueil Lebon).
Le Conseil d’État a précisé que la seule appartenance à la catégorie des personnels de direction, d’administration, de gestion et d’éducation mentionnée à l’article R. 216-5 du code de l’éducation ne suffit pas à ouvrir à ces personnels un droit à l’attribution d’un logement de fonction concédé par nécessité absolue de service : l’emploi occupé doit également figurer sur la liste arrêtée par l’organe délibérant de la collectivité territoriale de rattachement de l’établissement scolaire dans le respect du barème fixé par l’article R. 216-6 du même code, s’agissant du nombre de logements concédés par nécessité absolue de service (C.E., 12 décembre 2014, Département du Val-de-Marne, n° 367974, aux tables du Recueil Lebon – commenté dans la Lettre d’information juridique n° 187 du mois de mars 2015).
L'occupation du logement de fonction mis à la disposition d'un attaché d’administration chargé de la gestion matérielle et financière d'un établissement d'enseignement constitue cependant, pour cet agent, une obligation statutaire justifiée par l'intérêt du service. Sauf autorisation délivrée par le recteur d’académie, les attachés ou attachés principaux chargés de la gestion matérielle et financière d’un établissement scolaire ou des fonctions d’agent comptable sont tenus de résider sur leur lieu d’affectation (cf. article 2 du décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, dont les dispositions ont été reprises par le 3° de l’article 3-1 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'État).
Les autorisations de déroger à cette obligation sont accordées par le recteur d’académie et ne sont pas de droit pour les agents qui les sollicitent. Les recteurs peuvent définir, pour l'examen de ces demandes, des orientations générales (cf. C.A.A. Lyon, 12 juillet 2016, n° 14LY02368). 
QUESTIONS PROPRES AUX AGENTS AFFECTÉS DANS LES DOM/ROM/COM
 Affectation à Mayotte – Bénéfice de l’indemnité d’éloignement – Déplacement effectif (non) Affectation à Mayotte – Bénéfice de l’indemnité d’éloignement – Déplacement effectif (non)
C.A.A. Bordeaux, 21 février 2017, n° 15BX02314
Un secrétaire administratif de l’éducation nationale avait été placé en disponibilité du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 pour rejoindre son épouse à Mayotte. Par un arrêté du 5 avril 2012, avec effet au 9 mai 2012, il avait été réintégré dans son corps d’origine et affecté le même jour au vice-rectorat de Mayotte. Il avait alors demandé à bénéficier de l’indemnité d’éloignement prévue par l’article 2 du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l’attribution de l’indemnité d’éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’État en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux termes duquel le droit à l'indemnité d’éloignement est ouvert lors de l'affectation à Mayotte à la condition que cette affectation entraîne, pour l'agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux.
Par un jugement du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Mayotte avait rejeté la demande tendant à l’annulation de la décision ministérielle refusant de lui verser cette indemnité, qu’avait présentée l’intéressé. Ce dernier avait interjeté appel du jugement.
Par l’arrêt rendu le 21 février 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la requête d’appel en rappelant que le droit à l’indemnité d’éloignement n’est ouvert au fonctionnaire affecté dans la collectivité territoriale de Mayotte qu’à la condition qu’à la date de cette affectation, il se déplace effectivement vers cette collectivité qui n’est pas le centre de ses intérêts matériels et moraux.
La cour a précisé que le retour de requérant en métropole pour un court séjour durant sa disponibilité ne pouvait être regardé comme une nouvelle installation en métropole dès lors qu’il était installé à Mayotte depuis septembre 2011. Ainsi, sa prise de fonctions à Mayotte en mai 2012 ne pouvait être considérée comme ayant entraîné pour lui un déplacement effectif depuis la métropole au sens de l’article 2 du décret du 27 novembre 1996.
N.B. : Cet arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence du Conseil d’État relative aux conditions de versement de l’indemnité d’éloignement prévue par l’article 2 du décret du 27 novembre 1996 dont il résulte que seul l’agent qui se déplace effectivement depuis la métropole a droit à l’indemnité d’éloignement (cf. C.E., 19 mai 1995, Ministre de l’éducation nationale, n° 148236 ; C.E., 30 mai 2008, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, n° 280185). 
RÉPÉTITION DE L’INDU
 Titre exécutoire tendant au reversement de sommes perçues sur le fondement d’un acte inexistant – Inopérance du moyen tiré des fautes imputables à l'administration à avoir maintenu le versement indu de façon prolongée – Obligation de mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur d’une décision administrative (art. 4 de la loi du 12 avril 2000 devenu art. L. 111-2 du C.R.P.A.) – Absence d’irrégularité du titre exécutoire dans le cas où la lettre qui le notifie comporte ces mentions obligatoires Titre exécutoire tendant au reversement de sommes perçues sur le fondement d’un acte inexistant – Inopérance du moyen tiré des fautes imputables à l'administration à avoir maintenu le versement indu de façon prolongée – Obligation de mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur d’une décision administrative (art. 4 de la loi du 12 avril 2000 devenu art. L. 111-2 du C.R.P.A.) – Absence d’irrégularité du titre exécutoire dans le cas où la lettre qui le notifie comporte ces mentions obligatoires
C.E., 3 mars 2017, n° 398121, aux tables du Recueil Lebon
Une attachée territoriale exerçant les fonctions de secrétaire de maire au sein d’une commune avait perçu, à compter du 1er janvier 2008 et jusqu’à son admission à la retraite en 2012, un salaire correspondant au grade d’attaché territorial principal sur le fondement d’un document revêtu de la « griffe » du maire, qu’elle avait présenté comme un arrêté du maire de la commune la promouvant à ce grade. À la suite d’un contrôle de la chambre régionale des comptes, il était apparu que la délibération du conseil municipal auquel ce prétendu arrêté du maire faisait référence n’avait pas été prise et que ce document n’avait pas été édicté par le maire. Dans ces conditions, le maire avait émis et rendu exécutoire le 26 octobre 2012 un titre de recettes pour obtenir le reversement d’un montant de 33 890,52 euros correspondant aux sommes que l’intéressée avait irrégulièrement perçues sur le fondement de l’arrêté frauduleusement établi prononçant sa promotion de grade.
La secrétaire de mairie avait formé en vain une opposition à l’exécution de ce titre exécutoire devant le tribunal administratif de Nantes, puis devant la cour administrative d’appel de Nantes. Elle s’était pourvue en cassation contre l’arrêt rendu par cette cour.
Le Conseil d’État a rejeté son pourvoi, ce qui lui a donné l’occasion de trancher deux questions intéressantes.
La requérante soutenait que l’arrêt attaqué était entaché d’irrégularité faute d’avoir répondu à un moyen qu’elle avait soulevé, tiré de ce que le maire avait commis une faute en maintenant de façon prolongée le versement indu.
Le Conseil d’État a estimé que ce moyen soulevé devant la cour était inopérant, de sorte que les juges d’appel n’étaient pas tenus d’y répondre : il a en effet jugé que le moyen tiré de la faute commise par l’administration en maintenant un traitement indiciaire erroné de façon prolongée ne peut pas être utilement invoqué lorsque les sommes dont le remboursement est demandé ont été versées sur le fondement d’un acte inexistant.
L’intéressée soutenait par ailleurs que la cour avait commis une erreur de droit en écartant le moyen qu’elle soulevait, tiré de la méconnaissance des dispositions du second alinéa de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, désormais reprises au premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration (C.R.P.A.), aux termes desquelles : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
En l’espèce, le volet du titre exécutoire formant avis des sommes à payer adressé à la requérante ne comportait pas ces informations. Néanmoins, ce titre lui avait été notifié par une lettre signée par le maire et comportant le nom et le prénom de ce dernier. La cour en avait déduit qu’il n’en résultait pour l’intéressée, qui était secrétaire de la mairie, aucune ambiguïté quant à l’identité du signataire de la décision attaquée de sorte que le moyen pouvait être écarté.
Le Conseil d’État a jugé que, ce faisant, la cour n’avait commis aucune erreur de droit.
N.B. : Par une décision du 16 décembre 2009, n° 314907, mentionnée aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d’État avait rappelé que, lorsqu’il est saisi d’une opposition à l’exécution d’un titre de perception, le juge peut tenir compte d’une éventuelle faute commise par l’administration, consistant par exemple à n’avoir pas décelé, sur une période prolongée, une erreur relative à la rémunération d’un agent, pour réduire le montant du titre de perception.
Par la décision ici commentée, il précise que cette possibilité ne saurait jouer lorsque le versement indu, auquel le titre de perception tend à remédier, est fondé sur un acte juridiquement inexistant.
Pour mémoire, sont regardés comme juridiquement inexistants les actes qui sont entachés d’une illégalité d’une gravité telle qu’il convient de les regarder comme nuls et non avenus. En l’espèce, l’existence d’un arrêté promouvant l’intéressée au grade d’attaché territorial principal résultait d’une fraude caractérisée de sorte que cet arrêté ne pouvait qu’être regardé comme juridiquement inexistant.
Par cette décision, le Conseil d’État a également jugé que même si un titre de recettes ne comporte pas le nom, le prénom et la signature de son auteur, conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 désormais reprises au premier alinéa de l’article L. 212-1 du C.R.P.A., qui s’applique aux titres de perception (cf. C.E., 19 mars 2008, Ministre de l’éducation nationale c/ Mme X, n° 298049, aux tables du Recueil Lebon), cette absence n’est pas de nature à affecter la régularité du titre si la lettre par laquelle ce titre est notifié, à laquelle il est joint, mentionne ces éléments. Il en déduit que dans ce cas, il n’en résulte pour l’intéressé aucune ambiguïté quant à l’identité du signataire de la décision. 
Cessation de fonctions
RADIATION
 Condamnation pénale (infractions commises sur mineurs) – Incompatibilité avec l'exercice de fonctions en qualité de doctorant contractuel – Rupture du contrat doctoral Condamnation pénale (infractions commises sur mineurs) – Incompatibilité avec l'exercice de fonctions en qualité de doctorant contractuel – Rupture du contrat doctoral
T.A. Strasbourg, 8 décembre 2016, n° 1600268
Un requérant condamné pénalement pour détention et diffusion de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique et pour propositions sexuelles faites à un mineur par un majeur en utilisant un moyen de communication électronique avait demandé l’annulation de la décision par laquelle un président d’université avait décidé de mettre fin à son engagement en qualité de doctorant contractuel, en faisant notamment valoir que le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ne lui était pas applicable et que l'exercice de ses fonctions n’était pas incompatible avec les condamnations pénales dont il avait fait l’objet.
Le tribunal administratif a rejeté sa requête.
En premier lieu, le tribunal administratif a rappelé que « l’article 3 du décret du 17 janvier 1986, qui fait obstacle au recrutement d’un agent titulaire ayant fait l’objet d’une condamnation pénale incompatible avec l’exercice des fonctions envisagées, s’applique aux doctorants contractuels recrutés par les universités », puisque cet article 3 n'est pas au nombre des articles du décret du 17 janvier 1986, limitativement énumérés par l'article 10 du décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorant contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, qui ne sont pas applicables aux doctorants contractuels.
En second lieu, le tribunal a considéré que « si le contrat de recrutement de M. X ne lui confiait pas des tâches d’enseignement, il avait pour effet de le placer dans un environnement lui permettant d’avoir aisément des contacts avec des étudiants dont certains pourraient être mineurs ».
Il a donc jugé qu’« eu égard aux motifs des condamnations pénales infligées au requérant, l’université n’a pas commis d’erreur d’appréciation » en mettant fin à son engagement en qualité de doctorant contractuel.
N.B. : Ce jugement peut être rapproché de la décision par laquelle il a été jugé que « lorsque l'administration apprend que des mentions avaient été portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire d'un agent avec lequel elle a conclu un contrat de recrutement, il lui appartient, pour déterminer si ce contrat est entaché d'irrégularité, d'apprécier si, eu égard, d'une part, à l'objet des mentions en cause et à l'ensemble des motifs de la condamnation pénale dont l'agent a fait l'objet, d'autre part, aux caractéristiques des fonctions qu'il exerce, ces mentions sont incompatibles avec l'exercice de ces fonctions » (C.E., 4 février 2015, Centre hospitalier de Hyères, n° 367724, aux tables du Recueil Lebon).
Par ailleurs, il peut être rappelé que la loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 relative à l’information de l’administration par l’autorité judiciaire et à la protection des mineurs, dont les modalités de mise en œuvre ont été précisées par le décret n° 2016-612 du 18 mai 2016, prévoit l’obligation pour le ministère public d’informer l’administration d’une condamnation, même non définitive, pour des crimes et délits commis sur mineurs prononcée à l’encontre d’une personne exerçant une activité la mettant en contact habituel avec des mineurs (cf. LIJ n° 193, mai 2016). 
Questions propres aux agents non titulaires
LICENCIEMENT – NON-RENOUVELLEMENT D’ENGAGEMENT
 Agent non titulaire – Procédure de licenciement – Actes susceptibles de recours – Annulation par voie de conséquence – Opération complexe Agent non titulaire – Procédure de licenciement – Actes susceptibles de recours – Annulation par voie de conséquence – Opération complexe
C.E., avis, 23 décembre 2016, n° 402500, au Recueil Lebon
Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative d’une demande d’avis par le tribunal administratif de Melun, appelé à statuer sur la requête d’un agent contractuel de l’État tendant à l’annulation d’une décision par laquelle le ministre de la défense lui avait notifié son licenciement pour suppression de poste, le Conseil d’État a apporté des précisions sur la recevabilité des recours engagés contre les différents actes pris dans le cadre de la procédure de licenciement d’un agent contractuel, ainsi que sur les conséquences de l’annulation de ces actes.
Les dispositions de l’article 45-5 (créé par le décret n° 2014-1318 du 3 octobre 2014) du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, prévoient les modalités de la procédure de licenciement d’un agent non titulaire.
L’analyse de ces dispositions a conduit le Conseil d’État à préciser la nature de la décision initiale notifiant à l’agent son licenciement et ses motifs (II de l’article 45-5) et des actes ultérieurs relatifs au reclassement, au congé sans traitement ou au licenciement en cas de refus de l’emploi proposé par l’administration ou en cas d’impossibilité de reclassement au terme du congé de trois mois.
Le Conseil d’État a indiqué que tant la décision initiale, matérialisée sous forme de lettre recommandée, qui a pour effet de priver l’agent de l’emploi qu’il tenait de son contrat et, s’il n’est pas fait usage de la faculté de reclassement, de mettre fin à son emploi dans l’administration, que les décisions ultérieures prises sur le fondement du II de l’article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 sont des décisions faisant grief susceptibles de recours pour excès de pouvoir.
Par ailleurs, le Conseil d’État a précisé que, dans le cadre d’une procédure de reclassement, l’annulation de la décision initiale de licenciement emporte l’annulation, par voie de conséquence, des décisions ultérieures dans la mesure où elles constituent des éléments d’une opération complexe. À ce titre, un agent peut utilement exciper de l’illégalité de la décision de licenciement initiale, sans que puisse lui être opposé le caractère définitif de cette décision, à l’appui de conclusions dirigées contre les décisions prononçant son reclassement, son placement en congé sans traitement ou son licenciement en cas de refus de l’emploi proposé par l’administration ou d’impossibilité de reclassement au terme du congé de trois mois.
N.B. : L’application, par le Conseil d’État, de la théorie des opérations complexes à la procédure de licenciement d’un agent non titulaire conduit à la considérer comme une opération globale où chacune des décisions édictées permet l’élaboration de la décision suivante, jusqu’à la décision finale.
Le Conseil d’État étend ainsi le champ d’application d’une notion déjà applicable aux procédures de recrutement d’agents publics, notamment par voie de concours (cf. C.E., 23 mars 1994, n° 104420, au Recueil Lebon ; C.E., 1 er avril 1996, n° 108667, aux tables du Recueil Lebon). 
 Travailleur handicapé – Agent contractuel – Fin de contrat – Période d’essai (non) Travailleur handicapé – Agent contractuel – Fin de contrat – Période d’essai (non)
T.A. Cergy-Pontoise, 7 mars 2017, n° 1407719
Mme X, reconnue travailleur handicapé, avait été engagée par l’autorité académique en qualité d’agent contractuel pour une période d’un an à compter du 1er septembre 2013, en application du II de l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État qui prévoit un dispositif dérogatoire d’accès à la fonction publique pour les personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi des personnes handicapées. Par un arrêté du 1er octobre 2013, le recteur d’académie avait mis fin à son contrat à compter du 4 octobre 2013.
Le tribunal administratif a précisé que si l’article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État prévoit qu’une période d’essai peut être expressément prévue dans le contrat d’un agent afin de permettre à l’administration d’apprécier ses capacités professionnelles, il résulte des dispositions de l’article 11 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 que cet article n’est pas applicable aux agents recrutés sur le fondement de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984.
Le tribunal a ainsi rappelé qu’il n’existe aucune disposition législative ou réglementaire permettant de mettre un terme au contrat en cours d’un agent recruté sur le fondement de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984. Il a relevé que le contrat conclu entre la requérante et le recteur d’académie ne comportait d’ailleurs pas de clause relative à une période d’essai. Le recteur ayant ainsi commis une erreur de droit, le tribunal a annulé l’arrêté du 1er octobre 2013. 
 Calculs de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés payés Calculs de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés payés
C.A.A. Bordeaux, 7 mars 2017, n° 15BX00760
Mme X, maître auxiliaire, avait été licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 1er juin 2007.
Par un jugement du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de la Guadeloupe avait condamné l’État à lui verser un reliquat de l’indemnité de licenciement prévue par les dispositions des articles 51, 53 et 54 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et à lui payer l’indemnité compensatrice de congés payés prévue par les dispositions de l’article 10 du même décret du 17 janvier 1986.
Saisie d’un recours formé par la ministre de l’éducation nationale, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé l’article 3 du jugement prononçant ces condamnations :
– En ce qui concerne le reliquat de l’indemnité de licenciement retenu par le tribunal, la cour a rappelé que l’article 53 du décret du 17 janvier 1986 exclut du calcul de cette indemnité toute indemnité accessoire. La majoration de traitement instituée par la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de La Réunion ne pouvait donc pas être prise en compte dans le calcul de cette indemnité. Par suite, c’est à tort que les premiers juges l’y avaient intégrée (sur la nature d’indemnité liée à l’exercice des fonctions de cette majoration de traitement, cf. C.E., 28 décembre 2001, Syndicat Lutte pénitentiaire de l’Union régionale Antilles-Guyane, n° 236161, aux tables du Recueil Lebon) ;
– En ce qui concerne l’indemnité compensatrice de congés payés, la cour a rappelé qu’eu égard aux nécessités du service public de l’éducation, un enseignant ne peut exercer son droit à congé annuel, d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service, que pendant les périodes de vacance des classes, dont les dates sont arrêtées par le ministre de l’éducation. Un agent n’est donc en droit de prendre un congé annuel lors d’une période distincte de celles des périodes de vacance de classe que s’il n’a pas été en mesure d’exercer son droit à congé annuel pendant ces périodes au cours de l’année concernée (cf. C.E., 26 novembre 2012, Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, n° 349896, aux tables du Recueil Lebon).
En l’espèce, Mme X avait droit à onze jours de congés annuels rémunérés au titre de la période du 1er janvier au 1er juin 2007. Compte tenu du calendrier scolaire applicable en Guadeloupe, elle avait bénéficié de vingt jours de vacances des classes au cours de cette période et ne justifiait pas avoir été dans l’impossibilité de prendre ses onze jours de congés annuels pendant ces périodes de vacances des classes.
Dans ces conditions, la cour a considéré que c’était à tort que le tribunal administratif de la Guadeloupe lui avait reconnu un droit à bénéficier d’une indemnité compensatrice de congés annuels.
N.B. : Sur le calcul de l’indemnité de licenciement, il a par ailleurs été jugé que les sommes perçues au titre de la monétisation de jours épargnés sur un compte épargne-temps doivent être regardées comme constitutives d’indemnités accessoires au sens de l’article 53 du décret du 17 janvier 1986 et doivent, par suite, être exclues de ce calcul (cf. C.A.A. Paris, 12 novembre 2013, n° 12PA01031). 
Responsabilité
QUESTIONS GÉNÉRALES
Réparation du dommage
 Accident – Collège – Partage de responsabilités – Faute de la victime Accident – Collège – Partage de responsabilités – Faute de la victime
C.A.A. Paris, 24 mars 2017, n° 15PA01944
La mère d’un élève scolarisé en classe de sixième qui avait été victime d’un accident survenu dans la cour de son collège avait demandé au tribunal administratif de Melun de condamner solidairement l’État et le département dont relevait ce collège à réparer les préjudices subis par son fils du fait de cet accident.
Le tribunal administratif avait jugé que la faute commise par la victime était de nature à exonérer partiellement la responsabilité de la puissance publique et avait fixé à 25 % la part demeurant à la charge de l’élève, de sorte que l’État et le département avaient été condamnés solidairement à réparer les conséquences dommageables de l’accident à hauteur de 75 %.
Saisie d’une requête d’appel formée à l’encontre de ce jugement, la cour administrative d’appel de Paris a procédé à une évaluation plus importante du préjudice subi, mais elle a confirmé le partage de responsabilités retenu par les premiers juges à raison de la faute de la victime.
La cour a en effet considéré que l’élève avait participé à la survenance du dommage dès lors qu’il s’était rendu dans une cour du collège dont l’accès était interdit pendant le temps des récréations alors qu’il connaissait cette interdiction, et que ce comportement était de nature à exonérer d’une partie de leur responsabilité le département et l’État.
En l’espèce, le juge a estimé que la responsabilité de ces deux collectivités publiques était solidairement engagée à raison d’une partie des conséquences dommageables de l’accident car, d’une part, le chef d’établissement n’avait pas pris toutes les précautions de nature à assurer la sécurité des élèves en ne mettant en place aucune signalisation du banc défectueux, ce qui constitue une faute dans l’organisation du service engageant la responsabilité de l’État et, d’autre part, le département avait manqué à son obligation d’entretien normal de l’ouvrage public dont il avait la charge dès lors qu’il n’avait pas procédé au remplacement du banc défectueux. 
Procédure contentieuse
COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS
 Reprise de l'activité d'une entité économique par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif – Demande d’injonction à la personne publique de proposer un contrat de droit public aux salariés – Compétence judiciaire (non) Reprise de l'activité d'une entité économique par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif – Demande d’injonction à la personne publique de proposer un contrat de droit public aux salariés – Compétence judiciaire (non)
T.C., 9 janvier 2017, n° C4073, aux tables du Recueil Lebon
Une association de droit privé, dont les activités recouvraient l’aide à domicile des personnes âgées ou souffrant de handicap, l’assistance éducative en milieu ouvert, l’action de dynamisation des quartiers et l’aide sociale à l’enfance, avait été placée en liquidation judiciaire.
Après avoir obtenu l’annulation de l’autorisation donnée par l’inspecteur du travail de prononcer leur licenciement au motif que le mandataire liquidateur n’avait pas qualité pour engager une procédure de licenciement, plusieurs salariés protégés de cette association avaient demandé au département de La Réunion leur intégration dans les services de cette collectivité territoriale sur le fondement de l’article L. 1224-3 du code du travail, qui prévoit en son premier alinéa que : « Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. »
Leurs demandes ayant été implicitement rejetées, ils avaient demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler les refus ainsi opposés par le département et d’enjoindre à celui-ci de leur proposer un contrat de droit public.
Le département ayant excipé de l’incompétence de la juridiction administrative pour trancher ce litige, le tribunal avait renvoyé la question de compétence ainsi posée au Tribunal des conflits en application de l’article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015.
Le Tribunal des conflits a rappelé sa jurisprudence selon laquelle tant que les salariés concernés n’ont pas été placés sous un régime de droit public, leurs contrats demeurent des contrats de droit privé, de sorte que le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l'un ou l'autre des deux employeurs successifs de poursuivre l'exécution de ces contrats de travail, qui ne mettent en cause, jusqu'à la mise en œuvre du régime de droit public, que des rapports de droit privé et, partant, pour apprécier les conditions d’application des dispositions légales et leurs conséquences, notamment l’existence d’une entité économique transférée et poursuivie et la teneur des offres faites aux salariés (T.C., 9 mars 2015, Société Véolia propreté Nord Normandie c/ Communauté de communes de Desvres-Samer, n° C3994, aux tables du Recueil Lebon).
Il a cependant précisé que, conformément au principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, le juge judiciaire ne peut faire injonction à la personne publique de proposer des contrats de droit public, de sorte que lorsque le juge administratif est saisi de recours en annulation dirigés contre un refus de la personne publique d’accueillir les demandes des salariés et qu’il lui est demandé d’enjoindre à la personne publique de leur proposer des contrats de droit public, il ne peut statuer, en cas de différend sur la réunion des conditions du transfert, qu’après décision du juge judiciaire, saisi à titre préjudiciel.
En l’espèce, le tribunal administratif est donc bien compétent pour connaître du litige mais, dans la mesure où existe un différend sur la réunion des conditions du transfert, il ne pourra statuer qu’après qu’aura statué le juge judiciaire, saisi à titre préjudiciel. 
|
| |
Enseignement : questions générales
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Laïcité
 Doctorant contractuel – Signes d’appartenance religieuse – Laïcité Doctorant contractuel – Signes d’appartenance religieuse – Laïcité
Note DAJ B1 n° 2017-13 du 31 janvier 2017
Une université a saisi la direction des affaires juridiques d’une question relative à l’application du principe de neutralité religieuse aux agents publics.
Une doctorante contractuelle à qui il avait été proposé d’ajouter un avenant d’enseignement à son contrat doctoral avait souhaité savoir si elle pourrait enseigner en portant un foulard manifestant ses opinions religieuses. Devant le refus opposé par l’université qui se fondait sur le principe de neutralité auquel sont soumis tous les agents publics, la doctorante avait alors demandé si elle pourrait porter, à défaut d’un voile, un « biret » (sorte de chapeau utilisé traditionnellement lors des remises de diplômes). L’établissement souhaitait savoir si l’intéressée pouvait enseigner en portant cet accessoire.
L’article L. 952-2 du code de l’éducation, aux termes duquel : « Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité », ne peut faire obstacle au respect du principe de neutralité qui s’applique à tous les agents publics. Ce principe est désormais inscrit à l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire qui, depuis la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, prévoit désormais en ses deuxième et troisième alinéas que : « Dans l'exercice de ses fonctions, [le fonctionnaire] est tenu à l'obligation de neutralité. / Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. »
Les principes de neutralité et de laïcité interdisent donc aux fonctionnaires et agents publics exerçant leurs fonctions au sein des établissements d’enseignement supérieur de faire état de leur appartenance religieuse. Cette interdiction s’applique à tous les agents des services publics, et donc également aux doctorants contractuels, et plus largement à toutes les personnes bénéficiant d’un contrat de travail pour exercer des fonctions au sein de ces établissements.
Par suite, l’intéressée ne peut être autorisée à manifester ses convictions religieuses dans le cadre d’une activité d’enseignement, mais également dans l’exercice de son service exclusivement consacré aux activités de recherche liées à la préparation du doctorat.
Il convient de souligner que revêtent un caractère ostentatoire non seulement des signes religieux par eux-mêmes (tels qu’une croix ou une kippa par exemple), mais également ceux dont le caractère religieux se déduit du comportement de celui qui l’adopte. C’est ainsi que le Conseil d’État a considéré qu’une élève d’un établissement d’enseignement public qui avait remplacé son voile islamique traditionnel par un bandana qu’elle portait en permanence et qu’elle refusait d’ôter malgré les demandes réitérées de l’administration avait méconnu l’interdiction du port de signes par lesquels les élèves manifestent ostensiblement leur appartenance religieuse posée par l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation (C.E., 5 décembre 2007, n° 295671, au Recueil Lebon).
En l’espèce, le couvre-chef que la doctorante contractuelle proposait de substituer à son foulard semblait bien avoir pour objet de lui permettre de continuer à manifester ses opinions religieuses pendant son service. S’il était avéré que c’était bien le cas, il appartiendrait alors à l’université d’engager un dialogue avec l’intéressée pour lui rappeler les principes de neutralité et de laïcité imposés aux agents publics par la loi et la convaincre de porter des tenues neutres, dépourvues de connotation religieuse. 
Enseignement supérieur et recherche
ÉTUDES
Discipline des étudiants
 Discipline – Étudiant en master MEEF – Contrôle judiciaire Discipline – Étudiant en master MEEF – Contrôle judiciaire
Note DAJ B1 n° 2017-22 du 16 février 2017
Une université avait sollicité l’avis de la direction des affaires juridiques sur les suites susceptibles d’être réservées au placement sous contrôle judiciaire d’un étudiant inscrit dans l’établissement en vue de la préparation d’un master des métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF).
Cet étudiant avait été mis en examen pour détention d’images à caractère pédopornographique, sur le fondement des dispositions de l’article 227-23 du code pénal dont le premier alinéa prévoit, d’une part, que : « Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende » et, d’autre part, que : « Lorsque l'image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s'ils n'ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation. »
Cette mise en examen avait été assortie du placement sous contrôle judiciaire prévu par le 12° bis de l’article 138 du code de procédure pénale qui contraint l’intéressé à « ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise ».
Le placement sous contrôle judiciaire avait été notifié par le ministère public en application du 1° du II de l’article 706-47-4 du code de procédure pénale, créé par la loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 relative à l’information de l’administration par l’autorité judiciaire et à la protection des mineurs, qui dispose que le ministère public informe l’administration lorsqu’une personne qui exerce une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l’exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par l’administration est placée sous contrôle judiciaire et se trouve soumise à l’obligation prévue au 12° bis de l’article 138.
En raison de la nature des faits à l’origine des poursuites pénales et du diplôme préparé par l’étudiant, l’établissement souhaitait notamment savoir s’il pouvait lui interdire l’accès à ses locaux en application des dispositions du 1° de l’article R. 712-8 du code de l’éducation et engager une procédure disciplinaire à son encontre.
1. Le 1° de l’article R. 712-8 du code de l’éducation permet d’« interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l’établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l’accès de ces enceintes et locaux ». Cette interdiction d’accès aux locaux ne peut, toutefois, être que temporaire car elle « ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours », susceptible d’être, le cas échéant, prolongée jusqu’au prononcé d’une sanction disciplinaire ou judiciaire présentant un caractère définitif dans le cas où des poursuites disciplinaires ou pénales sont engagées.
Si l’existence de poursuites judiciaires offre la possibilité d’interdire, jusqu’à l’achèvement de la procédure, l’accès aux locaux de l’étudiant mis en examen et soumis à un contrôle judiciaire, la décision doit toutefois être fondée sur le constat, exigé par le 1° de l’article R. 712-8 du code de l’éducation, que sa présence dans les locaux de l’établissement est à l’origine d’un désordre ou constitue une menace de désordre.
2. La notification par le ministère public que des poursuites pénales ont été engagées à l’encontre de l’étudiant et qu’elles sont assorties d’un placement sous contrôle judiciaire suffit pour saisir la section disciplinaire de l’établissement concerné.
Les poursuites disciplinaires ne peuvent toutefois être valablement engagées que s’il est établi que les faits reprochés à l’étudiant sont, ainsi que l’exigent les dispositions du b) du 2° de l’article R. 712-10 du code de l’éducation, « de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'université ». À cet égard, l’atteinte portée à l’image de l’établissement par le comportement d’un usager se destinant à une carrière dans l’enseignement et qui se trouve mis en examen pour détention d’images à caractère pédopornographique entre dans le champ d’application de ces dispositions.
En tout état de cause, les éléments du dossier ayant conduit à la mise en examen d’une personne ne sont évidemment pas communiqués par l’autorité judiciaire. En effet, l’établissement n’a pas la qualité de « partie » dans l’affaire pénale et, de ce fait, les dispositions de l’article 114 du code de procédure pénale ne lui sont pas applicables. Les éléments de l’instruction pourraient, toutefois, être produits, pour sa défense, par l’étudiant lui-même, le Conseil d’État ayant rappelé que « le secret de l'instruction (…) n'est opposable, aux termes de l'article 11 du code de procédure pénale, qu'aux personnes qui concourent à la procédure et non, par conséquent, à la personne mise en examen » (C.E. Assemblée, 30 décembre 2014, n° 381245, au Recueil Lebon).
Toutefois, l'article 2 du décret n° 2016-612 du 18 mai 2016 relatif aux informations communiquées par l'autorité judiciaire aux administrations, notamment en cas de procédures concernant des personnes exerçant une activité les mettant en contact habituel avec des mineurs, a introduit dans le code de procédure pénale un article D. 1-13 dont le 3° du II prévoit que l’information adressée par le ministère public, en application de l’article 11-2 de ce même code, comporte « la qualification juridique détaillée des faits reprochés, leur date et lieu de commission, et leur description sommaire ».
Ces éléments d’information ont pour objectif de renseigner l’administration sur les agissements de la personne faisant l’objet d’une procédure pénale et peuvent servir de fondement à des poursuites disciplinaires. Si l’information communiquée par le ministère public ne comporte pas ces précisions, il convient de les lui demander. Il convient à cet égard de souligner que, si l’étudiant n’est pas directement employé par l’administration, sa formation, notamment s’il poursuit en deuxième année de master MEEF, nécessite la réalisation de différents stages dans des établissements d’enseignement en contact habituel avec des mineurs. 
Personnels
QUESTIONS COMMUNES
Droits et garantie
 Fonctionnaires et agents publics – Distribution de l’information syndicale – Technologies de l’information et de la communication – Messagerie électronique Fonctionnaires et agents publics – Distribution de l’information syndicale – Technologies de l’information et de la communication – Messagerie électronique
Note DAJ A2 n° 2017-0013 du 17 mars 201
Il a été demandé à la direction des affaires juridiques si la pratique de certaines organisations syndicales qui consiste à diffuser des informations syndicales aux personnels enseignants du premier degré par le biais des adresses fonctionnelles de messagerie électronique des écoles primaires est contraire aux dispositions réglementaires ayant trait aux conditions générales d'utilisation par les organisations syndicales des technologies de l'information et de la communication dans la fonction publique de l'État.
Par un arrêté du 4 novembre 2014, le ministre chargé de la fonction publique a fixé le cadre général de l’utilisation par les organisations syndicales des technologies de l’information et de la communication dans la fonction publique de l’État. L’article 5 de cet arrêté (cf. Titre 1er : Dispositions générales) prévoit notamment que : « (…) / Les échanges électroniques entre les agents et les organisations syndicales sont confidentiels. / Dans le respect des règles générales de sécurité du système d’information, les messages électroniques en provenance des organisations syndicales parviennent à leurs destinataire sans blocage ni lecture par un tiers. / (…) » et son article 8 (cf. Titre III : Utilisation de la messagerie électronique) rappelle que les agents destinataires des informations syndicales au moyen de « listes de diffusion composées des adresses de messageries professionnelles nominatives » établies par l’administration (listes créées par le service concerné sur la demande de l’organisation syndicale) doivent pouvoir exercer à tout moment leur libre choix d’accepter ou de refuser un message électronique syndical. Le III de ce même article 8 de l’arrêté prévoit également que : « (…) / Lorsque l’administration a été en mesure de mettre à la disposition des organisations syndicales un outil de gestion des listes de diffusion, celles-ci doivent nécessairement y recourir dans le cadre de l’utilisation des listes mentionnées au I du présent article. / (…). »
Il résulte des dispositions de cet arrêté du 4 novembre 2014 que les organisations syndicales ne sont pas autorisées à utiliser les adresses électroniques fonctionnelles des services dès lors qu’en vertu d’une décision du 26 avril 2016, le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a mis à leur disposition des listes de diffusion.
La diffusion d’informations à caractère syndical par la voie des adresses électroniques fonctionnelles des services et écoles ne permet d’ailleurs pas de préserver le libre choix des agents destinataires de ces messages électroniques de les accepter ou les refuser dans la mesure où la messagerie électronique fonctionnelle d’un service ou d’un établissement (adresse de courrier électronique propre à la structure administrative) comprend par définition plusieurs utilisateurs individuels habilités à consulter, saisir ou envoyer des courriels, à la différence d’une messagerie électronique mise à la disposition d’un agent pour l’exercice de ses fonctions (avec une adresse individuelle de courrier électronique attachée à l’agent concerné). 
 Fonctionnaires et agents publics – Droit syndical – Participation à un congrès ou une réunion de l’organisme directeur du syndicat – Autorisation d’absence – Article 13 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 Fonctionnaires et agents publics – Droit syndical – Participation à un congrès ou une réunion de l’organisme directeur du syndicat – Autorisation d’absence – Article 13 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982
Note DAJ A2 n° 2017-0011 du 8 mars 2017
La direction des affaires juridiques a été interrogée sur les suites à donner à une demande d’autorisation spéciale d’absence présentée sur le fondement de l’article 13 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 par un enseignant, membre du bureau d’un syndicat dont il est adhérent, aux fins d’assister à « l’organisme directeur de son syndicat ».
Le premier alinéa de l’article 13 du décret du 28 mai 1982 prévoit que : « Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mentionnées aux 1° et 2°, qui sont mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de l'organisation, dans les conditions suivantes : / (…). »
Les organisations syndicales mentionnées aux 1° et 2° de cet article 13 du décret sont les unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au Conseil commun de la fonction publique (a du 1° de l’article 13), les syndicats nationaux et locaux, les unions régionales et les unions départementales de syndicats affiliés aux unions, fédérations ou confédérations qui viennent d’être mentionnées (b du 1°), les organisations syndicales internationales (a du 2°), les unions, fédérations ou confédérations de syndicats représentées au Conseil commun de la fonction publique (b du 2°) et les syndicats nationaux et locaux, les unions régionales et les unions départementales de syndicats affiliés aux unions, fédérations ou confédérations de syndicats représentées au Conseil commun de la fonction publique (c du 2°).
L’article 2 du même décret prévoit par ailleurs que : « Les organisations syndicales déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à charge pour les responsables de ces organisations d’en informer l’administration. »
Il ressort de ces dispositions que les autorisations spéciales d’absence prévues par l’article 13 du décret du 28 mai 1982 pour assister à un congrès syndical ou à une réunion d’un organisme directeur de l’une des organisations syndicales mentionnées à ce même article 13 peuvent être accordées, sous réserve des nécessités du service, à un agent qui a été nommément désigné, conformément aux statuts de l’organisation syndicale à laquelle il appartient, pour assister à ce congrès ou à la réunion de cet organisme directeur, ou qui a la qualité de membre élu de cet organisme directeur.
En effet, en vertu de la liberté dont elles bénéficient pour s’organiser dans le respect des textes en vigueur, les organisations syndicales sont libres de désigner les membres de leurs organismes directeurs ou leurs représentants aux réunions de ces organismes directeurs ou aux congrès qu’elles organisent.
Ainsi, un simple adhérent d’un syndicat, qui n’est pas investi d’un mandat syndical, pourra néanmoins bénéficier d’une autorisation spéciale d’absence sur le fondement de l’article 13 du décret du 28 mai 1982 s’il a été spécialement mandaté par son syndicat pour le représenter à un congrès ou à une réunion d’un organisme directeur du syndicat.
Le 3.2.1 de la circulaire du ministère de la fonction publique n° SE1 2014-2 du 3 juillet 2014 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique de l’État précise ainsi que : « Tout représentant syndical dûment mandaté par l'organisation syndicale à laquelle il appartient a le droit de s'absenter, sous réserve des nécessités du service, afin de participer à des congrès ou des réunions d’organismes directeurs de syndicats, quel que soit le niveau de ces syndicats. (…) / Les agents susceptibles d'obtenir une autorisation spéciale d'absence en application de l'article 13 doivent avoir été désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et doivent justifier du mandat dont ils ont été investis. (…). »
La direction des affaires juridiques a également souligné que ni les dispositions précitées de l’article 13 du décret du 28 mai 1982, ni aucune autre disposition réglementaire ne prévoient que, pour bénéficier des autorisations spéciales d’absence prévues par cet article 13 du décret, le représentant d’une des organisations syndicales mentionnées par cet article doive avoir été obligatoirement élu lors d’élections professionnelles, ni d’ailleurs qu’il doive appartenir à une organisation syndicale représentative (cf. C.E., 15 mai 2009, Fédération C.N.T.-P.T.T., n° 299205, aux tables du Recueil Lebon).
Ainsi, seul un motif tiré des nécessités du service peut légalement fonder un refus d’autorisation spéciale d’absence opposé à un agent qui remplit les conditions posées par l’article 13 du décret du 28 mai 1982. Le motif tiré des nécessités du service fait l’objet d’un contrôle du juge qui veille à ce qu’il ne soit pas utilisé pour faire obstacle à l’exercice de la liberté syndicale, laquelle constitue une liberté fondamentale (cf. J.R.C.E., 19 décembre 2008, Syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion, n° 323072). 
Rémunérations, traitement et avantages en nature
 Allocation d’invalidité temporaire – Suspension – Disponibilité d’office – Fonctionnaire Allocation d’invalidité temporaire – Suspension – Disponibilité d’office – Fonctionnaire
Note DAJ B1 n° 2017-14 du 31 janvier 2017
Un établissement d’enseignement supérieur souhaitait savoir s’il pouvait légalement suspendre le versement de l’allocation d’invalidité temporaire dont bénéficiait l’un de ses agents en disponibilité d’office pour raisons de santé au motif qu’il refusait de déférer aux convocations du comité médical appelé à émettre un avis sur sa situation. L’établissement interrogeait également la direction des affaires juridiques sur l’instance médicale compétente pour se prononcer sur l’éventuelle attribution à l’intéressé d’une quatrième année de disponibilité d’office.
Le fonctionnaire avait été, après épuisement de ses droits à congé de longue durée, placé en disponibilité d’office pendant une durée totale de trois années. Pendant cette même période, il avait bénéficié de l’allocation d’invalidité temporaire (AIT) du groupe II, prévue par les articles D. 712-13 à D. 712-18 du code de la sécurité sociale.
Dans le cadre de l’examen de l’éventuelle attribution d’un troisième renouvellement de la disponibilité d’office dont il bénéficiait (pour une quatrième année, par conséquent), dans les conditions prévues par l’article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, l’intéressé avait été convoqué devant le comité médical départemental. L’agent ne s’était pas présenté à cette convocation du comité médical, pas plus qu’il ne s’était présenté à la seconde convocation du comité médical.
1. Aucune disposition législative ou réglementaire ne permet à l’administration d’interrompre le versement de l’allocation d’invalidité temporaire dont bénéficie un fonctionnaire au motif que ce dernier a refusé de se soumettre au contrôle, par le comité médical départemental, de son aptitude à l’exercice de ses fonctions.
Ainsi, l’article 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 prévoit en son point 4 que la commission de réforme est consultée sur « la reconnaissance et la détermination du taux de l’invalidité temporaire ouvrant droit au bénéfice de l’allocation d’invalidité temporaire prévue à l’article 8 bis du décret du 26 octobre 1947 modifié ».
L’article D. 712-15 du code de la sécurité sociale précise que : « L'invalidité temporaire est appréciée par la commission de réforme, compte tenu du barème indicatif prévu au troisième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires, que l'état des intéressés leur interdise ou non d'exercer une activité rémunérée autre que leur emploi. / La commission de réforme se prononce : / 1°) en vue de l'attribution de l'allocation d'invalidité temporaire mentionnée à l'article D. 712-18, à compter de l'expiration des droits statutaires à un traitement ou du service de l'indemnité mentionnée à l'article D. 712-12 ; / (…). »
En outre, l’article D. 712-18 du même code, après avoir rappelé que l’allocation d’invalidité temporaire est liquidée et payée par l’administration ou l’établissement auquel appartient le fonctionnaire, mais que le classement des agents dans l’un des trois groupes d’allocation existants est effectué, en vue de la détermination du montant de l’allocation qui leur est servie, par la commission de réforme, énonce en son dernier alinéa que : « L’allocation cesse d’être servie dès que le fonctionnaire est réintégré dans ses fonctions ou mis à la retraite et, en tout état de cause, à l'âge prévu par l’article L. 161-17-2. »
Il résulte de ces dispositions que le versement de l’allocation d’invalidité temporaire est soumis à l’avis préalable de la commission de réforme. De la même manière, l’interruption du versement de cette allocation ne saurait intervenir sans avis préalable de la commission de réforme.
2. Le placement de l’agent en disponibilité d’office pour une quatrième année (troisième renouvellement) requiert un avis préalable du comité médical départemental et de la commission de réforme.
En effet, l’article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonction, qui traite de la disponibilité d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie, prévoit en ses deux derniers alinéas que : « La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement. »
Ces dispositions réglementaires sont reprises par l’article 48 susmentionné du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / Elle est accordée pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale. / Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement. / L'avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu du deuxième alinéa de l'article 34 (4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement de la mise en disponibilité, l'avis est donné par la commission de réforme. »
En outre, il résulte des dispositions de l’article 7 de ce même décret du 14 mars 1986 que le comité médical départemental est obligatoirement consulté sur : « (…) / 5. L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé ou disponibilité ; / 6. La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ; / 7. Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires (…) », et des dispositions de l’article 13 du même décret que la commission de réforme est consultée sur : « (…) / 6. L'application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite. / 7. L'application, s'il y a lieu, des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité d'office pour raison de santé (…) ».
Il résulte de ces dispositions réglementaires que le renouvellement de la disponibilité d’office pour une éventuelle quatrième année (troisième renouvellement) requiert, en premier lieu, l’avis du comité médical départemental qui doit se prononcer sur la possibilité pour l’intéressé de reprendre ses fonctions avant l’expiration de la quatrième année de disponibilité et, en second lieu, l’avis de la commission de réforme sur l’inaptitude du fonctionnaire à la reprise des fonctions et son éventuelle admission à la retraite pour invalidité.
Enfin, en application de l’article 48 déjà mentionné du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, l’attribution d’une quatrième année de disponibilité d’office pour raisons de santé n’est pas un droit : cette quatrième année ne peut être accordée à l’agent que si le comité médical estime qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration de cette quatrième année de disponibilité. Il en résulte que si le fonctionnaire ne se rend pas, sans motif légitime, aux convocations du comité médical départemental et, par conséquent, ne met pas ce dernier en mesure de se prononcer sur son aptitude à reprendre ses fonctions avant la fin de la quatrième année de disponibilité, il ne pourra pas bénéficier de ce troisième renouvellement de sa disponibilité d’office pour une quatrième année.
Dans cette hypothèse, devront lui être appliquées les dispositions précitées de l’article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 : à l’expiration de la disponibilité d’office, l’agent, « s’il n’a pu bénéficier d’un reclassement, est soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié ».
Si, sans motif légitime, le fonctionnaire ne se rend pas aux convocations des instances médicales compétentes, il les met dans l’incapacité de juger de son aptitude ou inaptitude à l’exercice de ses fonctions, ce qui conduira ces instances médicales à dresser un procès-verbal de carence qui permettra alors à l’administration de prendre, au vu des éléments dont elle dispose, la décision qui lui paraît fondée en droit, à savoir, dès lors que le fonctionnaire a épuisé ses droits à congé de longue durée, et en l’absence d’avis médical permettant une réintégration dans les fonctions ou un reclassement dans d’autres fonctions, soit une admission à la retraite, soit, en l’absence de droits à pension, un licenciement (cf. C.E., 15 juillet 2008, n° 290965).
La direction des affaires juridiques a également souligné la nécessité d’appeler l’attention de l’agent concerné sur les dispositions réglementaires applicables à sa situation et les risques auxquels il s’expose en ne se présentant pas, sans justifier d’un motif légitime, aux convocations du comité médical et de la commission de réforme et en faisant par là même obstacle aux contrôles médicaux que ces instances sont tenues d’effectuer : perte de droits éventuels et risque d’admission d’office à la retraite ou de licenciement. 
Discipline
 Discipline – Enseignant-chercheur retraité Discipline – Enseignant-chercheur retraité
Note DAJ B1 n° 2017-35 du 7 mars 2017
Il a été demandé à la direction des affaires juridiques si des poursuites disciplinaires pouvaient être engagées à l’encontre d’un enseignant-chercheur retraité pour des faits commis antérieurement à son admission à la retraite.
À cette occasion, il a été rappelé que seuls les enseignants-chercheurs en activité peuvent être déférés devant la section disciplinaire du conseil académique (ou de l’organe en tenant lieu) d’un établissement d’enseignement supérieur. En effet, les sanctions disciplinaires prévues par les dispositions de l’article L. 952-8 du code de l’éducation et applicables aux enseignants-chercheurs affectent le déroulement de la carrière de ces derniers. Elles ne peuvent donc être infligées à un enseignant-chercheur retraité dont la carrière est achevée.
En tout état de cause, le Conseil d’État a été amené à préciser, de longue date, que l’admission à la retraite d’un fonctionnaire fait obstacle à ce que lui soit infligée une sanction disciplinaire ayant pour objet d’exclure ce dernier des cadres ou de modifier sa situation dans les cadres (C.E. Section, 3 mai 1946, Sieur Truitard, n° 78901, au Recueil Lebon ; C.E., 6 février 1948, Sieur Jacquemot, n° 84701, au Recueil Lebon).
Cette jurisprudence a été rappelée par le Conseil d’État dans un avis rendu le 5 août 1986 (Section des finances, n° 340520) qui a, en outre, précisé qu’il ne peut être fait application de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui pose le principe selon lequel une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un « fonctionnaire », dans la mesure où l’article 24 de cette même loi dispose que la cessation définitive des fonctions, qui est l’un des effets de l’admission à la retraite, entraîne la « perte de la qualité de fonctionnaire ».
Le Conseil d’État a toutefois souligné dans ce même avis que « la procédure disciplinaire prévue pour les fonctionnaires en activité ne peut être légalement engagée à l’encontre d’un fonctionnaire retraité, lorsque les faits reprochés n’ont été connus de l’autorité compétente qu’après l’admission à la retraite, que dans la seule mesure où la décision admettant le fonctionnaire à la retraite n’est pas devenue définitive ». 
QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE
Personnels enseignants
 Personnel enseignant – Obligations de service – Participation à l’encadrement et la correction d’épreuves préparant au diplôme national du brevet Personnel enseignant – Obligations de service – Participation à l’encadrement et la correction d’épreuves préparant au diplôme national du brevet
Note DAJ A2 n° 2017-0007 du 14 février 2017
La direction des affaires juridiques a été interrogée sur le régime applicable à la participation des personnels enseignants à l’encadrement et à la correction d’épreuves des « brevets blancs » organisées au cours de l’année scolaire par leur collège pour la préparation des élèves des classes de troisième aux épreuves de l’examen du diplôme national du brevet.
1. Il ressort des dispositions de l’article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré que ceux-ci « sont tenus d’assurer, sur l’ensemble de l’année scolaire : / (…) / II. Les missions liées au service d’enseignement qui comprennent (…) l’aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, (…) le travail au sein d’équipes pédagogiques (…) ».
La participation à l’encadrement et à la correction d’épreuves du « brevet blanc » s’inscrit donc bien dans les missions statutaires des enseignants au sens des dispositions du décret du 20 août 2014. L’évaluation des élèves par les personnels enseignants ne peut se limiter aux seuls interrogations et devoirs auxquels l’enseignant soumet les élèves de ses classes tout au long de l’année scolaire dans la mesure où la nécessité de repérer les difficultés des élèves afin de mieux assurer la progression des apprentissages amène les personnels à pratiquer différentes formes d’évaluation1.
Un enseignant ne peut donc pas refuser d’apporter son concours à la correction d’épreuves d’entraînement au diplôme national du brevet que subissent les élèves d’autres classes que les siennes puisqu’avec ses collègues, il forme une équipe pédagogique définie par l’article L. 912-1 du code de l’éducation comme « constitué[e] des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d’élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire (…). Les personnels d’éducation y sont associés ».
L’entrée en vigueur du décret du 20 août 2014 susmentionné n’a pas modifié l’état du droit sur ce point.
2. La participation à l’encadrement et à la correction des épreuves du brevet blanc ne peut donner lieu à une rémunération supplémentaire dans la mesure où ces activités font partie des missions statutaires des enseignants liées à leur service d’enseignement et où aucun texte ne prévoit une telle rémunération.
Le versement d’une rémunération supplémentaire est limité au seul cas de la participation d’enseignants à des activités liées au fonctionnement de jurys de l’examen du diplôme national du brevet dans les conditions fixées par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d’activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement et par l’arrêté du 13 avril 2012 relatif à la rémunération des intervenants participant à titre d’activité accessoire à des activités liées au fonctionnement de jurys d’examens conduisant à la délivrance de diplômes ou certificats relevant du ministre chargé de l’éducation nationale. 
NOTES
1. La connaissance des différentes formes d’évaluation ainsi que les usages qui peuvent en être faits est d’ailleurs une des compétences nécessaires pour l’exercice du métier d’enseignant (cf. arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation). [retour]
|
|
 La codification par le code des relations entre le public et l’administration de règles jurisprudentielles en matière d’entrée et de sortie de vigueur des actes administratifs unilatéraux La codification par le code des relations entre le public et l’administration de règles jurisprudentielles en matière d’entrée et de sortie de vigueur des actes administratifs unilatéraux
Dans son étude annuelle 2016 intitulée « Simplification et qualité du droit » (p. 69-70), le Conseil d’État relève que « la codification a beaucoup progressé depuis dix ans sous la double impulsion du Gouvernement et du Parlement et [que] le nouveau programme de codification fixé en mars 2013 [circulaire du Premier ministre n° 5643/SG du 27 mars 2013] est désormais presque achevé », même si « quelques codes importants sont encore en chantier, dont le code de la commande publique et le code de la fonction publique ».
Le Conseil d’État ajoute que « parmi les nouveaux codes, le code des relations entre le public et l’administration, publié en octobre 2015 après une longue gestation, occupe une place à part compte tenu de son objet ».
Le code des relations entre le public et l’administration (C.R.P.A.) traite de la procédure administrative non contentieuse. Ainsi que l’expose le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, ce code est destiné à être la lex generalis des relations du public avec l’administration2.
À cet égard, le II de l’article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que : « Ce code regroupe et organise les règles générales relatives aux procédures administratives non contentieuses régissant les relations entre le public et les administrations de l'État et des collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes chargés d'une mission de service public. Il détermine celles de ces règles qui sont applicables aux relations entre ces administrations et entre ces administrations et leurs agents. Il rassemble les règles générales relatives au régime des actes administratifs (…). »
Il n’est pas inutile sur ce point de signaler que le C.R.P.A. rompt avec la structuration traditionnelle des codes en deux parties distinctes, une partie législative et une partie réglementaire, et « propose, de manière inédite, une numérotation continue des dispositions de nature législative et réglementaire afin qu’elles puissent se succéder dans un document unique (…). Ainsi, une fois identifiée la thématique qui les intéresse, le public et l’administration auront un accès facilité à l’ensemble des dispositions applicables, sans avoir à se reporter à une autre partie du texte. » (Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 23 octobre 2015)
Le C.R.P.A. procède à la codification des principales dispositions des grandes lois et ordonnances ainsi que des décrets relatifs aux droits des administrés :
– loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (codification notamment des dispositions relatives à la liberté d’accès aux documents administratifs) ;
– loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
– loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations relative (codification notamment des dispositions relatives au principe dit du « silence vaut accord » qui avaient été introduites par la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013) ;
– ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs ;
– ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
– décret n° 99-68 du 2 février 1999 relatif à la mise en ligne des documents administratifs ;
– décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil ;
– décret n° 2001-899 du 1er octobre 2001 portant abrogation des dispositions réglementaires relatives à la certification conforme des copies de documents délivrés par les autorités administratives.
Mais, outre la codification de dispositions législatives et réglementaires, le C.R.P.A. hisse au niveau législatif tout un ensemble de règles jurisprudentielles.
Cette codification concerne en particulier les règles applicables en matière d’entrée et de sortie de vigueur des actes administratifs unilatéraux.
À titre liminaire, il convient de souligner qu’après avoir rappelé qu’il existe des actes décisoires et des actes non décisoires, l’article L. 200-1 du C.R.P.A. dispose que : « (…) Les actes administratifs unilatéraux décisoires comprennent les actes réglementaires, les actes individuels et les autres actes décisoires non réglementaires. Ils peuvent être également désignés sous le terme de décisions ou, selon le cas, sous les expressions de décisions réglementaires, de décisions individuelles et de décisions ni réglementaires ni individuelles. »
Il existe donc trois catégories d’actes :
– les actes réglementaires qui se définissent par la généralité de la norme qu’ils édictent et dont les effets sont impersonnels ;
– les actes individuels qui se définissent par leur objet particulier et dont les effets sont personnels ;
La catégorie des actes individuels comprend elle-même deux catégories :
** les actes individuels créateurs de droits : « Sont créateurs de droits les actes qui donnent aux intéressés une situation sur laquelle il n’est pas possible en principe à l’administration de revenir », à l’exemple d’une décision accordant un avantage financier alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage (C.E. Section, 6 novembre 2002, n° 223041, au Recueil Lebon) ou d’une décision de nomination (C.E. Section, 10 octobre 1997, n° 170341, au Recueil Lebon) ;
** les actes individuels non créateurs de droits, à l’exemple des mesures qui se bornent à procéder à la liquidation d’une créance née d’une décision prise antérieurement (C.E. Section, 6 novembre 2002, Soulier, n° 223041, au Recueil Lebon).
– les actes ni réglementaires ni individuels qui ne sont pas sans rappeler ce que la doctrine a coutume d’appeler les décisions d’espèce, c’est-à-dire des actes hybrides qui empruntent à l’acte réglementaire son caractère impersonnel et à l’acte individuel son caractère particulier.
L’objet de la présente étude est de présenter les grandes lignes de cette codification de règles jurisprudentielles en matière d’entrée (I) et de sortie (II) de vigueur des actes administratifs unilatéraux.
I. L’ENTRÉE EN VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS UNILATÉRAUX
L'entrée en vigueur d’un acte administratif résulte de la conjugaison de trois conditions :
– l’existence de l’acte qui « n'est pas subordonnée à sa publication ou à sa notification » (C.E. Assemblée, 21 décembre 1990, nos 105743, 105810, 105811 et 105812, au Recueil Lebon) mais à sa signature3, laquelle n’est pas sans produire des effets juridiques ;
Ainsi, un acte administratif individuel favorable crée dès sa signature des droits pour son destinataire (C.E. Section, 19 décembre 1952, n° 7133, Demoiselle Mattéi, au Recueil Lebon )4.
Pour les actes réglementaires, il a été jugé que « des mesures réglementaires peuvent être prises pour l'application d'une disposition existante mais non encore publiée, à la condition qu'elles n'entrent pas en vigueur avant que la disposition sur laquelle elles se fondent ait été régulièrement rendue opposable aux tiers », mais qu’« un arrêté pris pour l'application d'un arrêté signé mais non encore publié ne peut, sans méconnaître le principe selon lequel la légalité d'un acte administratif s'apprécie au regard des dispositions en vigueur à la date de sa signature, être légalement pris sans qu'eût été recueilli au préalable l'avis requis par des dispositions dont l'abrogation est prévue par le premier arrêté. La circonstance que ces deux arrêtés ont été publiés simultanément au Journal officiel est sans influence sur la légalité, appréciée à la date de sa signature, du second » (C.E. Section, 30 juillet 2003, Groupement des éleveurs mayennais de trotteurs, n° 237201, au Recueil Lebon).
– l’opposabilité de l’acte qui tient à sa publicité, dont les modalités diffèrent selon que l’acte est réglementaire ou non. La publicité permet de porter l’acte à la connaissance du public et de faire courir le délai de recours en particulier à l’égard des tiers, mais elle est sans incidence sur la légalité de l’acte qui s’apprécie à la date de sa signature5 ;
** L’article L. 221-2 du C.R.P.A. organise les règles de publicité des actes réglementaires : elles procèdent « de l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie (…) d’une publication ou d’un affichage », qui doit intervenir dans un délai raisonnable (C.E., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale, n° 243430, au Recueil Lebon). L’article L. 221-7 du même code renvoie à ces mêmes règles pour la publicité des décisions ni réglementaires ni individuelles.
Les décrets et, lorsqu’une loi ou un décret le prévoit, les autres actes administratifs sont publiés au Journal officiel de la République française sous forme électronique (articles L. 221-9 et L. 221-10 du C.R.P.A.).
Il a été jugé que « la publication d'une décision administrative dans un recueil autre que le Journal officiel fait courir le délai du recours contentieux à l'égard de tous les tiers si l'obligation de publier cette décision dans ce recueil résulte d'un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française », mais qu’« en l'absence d'une telle obligation, cet effet n'est attaché à la publication que si le recueil peut, eu égard à l'ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d'avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision » (C.E. Section, 27 juillet 2005, n° 259004, au Recueil Lebon).
Pour les actes réglementaires des établissements publics, il a été jugé « qu'en l'absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les délibérations ayant un caractère réglementaire d'un établissement public sont opposables aux tiers à compter de la date de leur publication au bulletin officiel de cet établissement ou de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique ; [mais] que, toutefois, compte tenu de l'objet des délibérations et des personnes qu'elles peuvent concerner, d'autres modalités sont susceptibles d'assurer une publicité suffisante » (C.E., 24 avril 2012, Établissement public Voies navigables de France, n° 339669, au Recueil Lebon).
Pour les circulaires ministérielles, l’article R. 312-8 du C.R.P.A. codifie le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 qui exige leur mise en ligne sur le site circulaires.legifrance.gouv.fr, sans préjudice d’une publication des « instructions, circulaires ainsi que [d]es notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administrative » (article L. 312-2 du C.R.P.A.) dans des bulletins officiels (article R. 312-3 du C.R.P.A.). L’administration ne peut se prévaloir d’une circulaire qui n’a pas été à la fois mise en ligne sur ce site et publiée dans un bulletin officiel (C.E., 24 octobre 2011, Ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, n° 345514, aux tables du Recueil Lebon).
** La publicité des décisions individuelles expresses procède d’une notification ainsi que le prévoit l’article L. 221-8 du C.R.P.A., aux termes duquel : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée. »
Il a été jugé que « si la notification [d’une] décision à la personne intéressée [entraîne] l'expiration du délai de recours en ce qui la concerne, le défaut de publication de ladite décision empêche ce délai de courir à l'égard des tiers » (C.E. Section, 27 avril 1988, n° 24039, au Recueil Lebon).
Certaines décisions individuelles doivent d’ailleurs être publiées. Ainsi, l’article 28 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État dont les dispositions sont précisées par le décret n° 63-280 du 19 mars 1963 relatif à la publication des décisions concernant la situation individuelle des fonctionnaires prévoit une publication au Journal officiel de la République française des décisions de nomination, promotion de grades et mises à la retraite des fonctionnaires nommés par décret du président de la République et de ceux nommés par arrêté s’ils sont de catégorie A.
Pour les autres fonctionnaires, la publication au Journal officiel n’est pas obligatoire et peut être assurée par tout autre procédé, tel que l’insertion au bulletin officiel, sous la forme d’une publication de l’intégralité de la décision ou de seulement un extrait avec mention de l’objet, de la nature, de l’auteur et de la date de la décision.
– l’applicabilité de l’acte dans le temps qui est gouvernée par deux règles jurisprudentielles dont le C.R.P.A. procède à la codification : le principe de non-rétroactivité des actes administratifs (A) et l’obligation d’édicter s’il y a lieu pour des motifs de sécurité juridique des mesures transitoires (B).
A. Le principe de la non-rétroactivité des actes administratifs et ses tempéraments
1. Un principe général du droit hissé au niveau législatif
L’article L. 221-4 du C.R.P.A. prévoit que : « Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date. »
Par cette disposition, le C.R.P.A. consacre l’une des implications du principe général du droit de non-rétroactivité des actes administratifs qui gouverne l’entrée en vigueur des actes administratifs unilatéraux. Le Conseil d’État avait en effet jugé qu’« une réglementation nouvelle a, en principe, vocation à s'appliquer immédiatement, sous réserve (…) du respect des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs » (C.E. Section, 13 décembre 2006, n° 287845, au Recueil Lebon).
Ce principe général du droit est celui selon lequel « les règlements ne disposent que pour l’avenir » (C.E. Assemblée, 25 juin 1948, Société du Journal l'Aurore, n° 94511, au Recueil Lebon).
Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs aussi bien réglementaires qu’individuels6 n’interdit pas à l’administration de modifier à tout moment et pour l’avenir une norme sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes puissent invoquer un droit au maintien de la réglementation existante (C.E., 17 octobre 1997, n° 182963, au Recueil Lebon).
Mais ce principe interdit à l’administration de prévoir une entrée en vigueur de ses décisions, réglementaires ou non, à une date antérieure à celle de leur publication ou de leur notification (C.E. Section, 25 mars 1983, n° 08699, au Recueil Lebon). La rétroactivité n’a toutefois pas nécessairement pour conséquence l’illégalité totale de l’acte qui en est entaché. En effet, l’acte peut faire l’objet d’une annulation partielle en tant seulement qu’il prend effet rétroactivement (C.E. Assemblée, 26 juin 1998, nos 194151, 194152, 195427, 195428, 195429, 195430, au Recueil Lebon).
Précisément, ce principe fait obstacle à ce qu’une règle nouvelle :
– remette en cause des situations déjà constituées sous l’empire des anciennes règles, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État en considérant « qu'en principe, lorsque de nouvelles normes générales sont édictées par voie de décret ou d'arrêté, elles ont vocation à s'appliquer immédiatement, sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes puissent invoquer le droit au maintien de la réglementation existante, sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, qui exclut que les nouvelles dispositions s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant l'entrée en vigueur de ces dispositions » (C.E., 11 décembre 2013, n° 362987, aux tables du Recueil Lebon). Dans cette dernière décision, il a toutefois jugé « qu'en matière d'enseignement, ce principe ne fait pas obstacle à l'application immédiate, même aux élèves engagés dans un cycle de formation sanctionné par un diplôme, des dispositions réglementaires relatives à la formation qui leur est dispensée et, notamment, aux modalités d'évaluation des connaissances » ;
Au sujet d’une modification des obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans un établissement d’enseignement supérieur, le Conseil d’État a jugé qu’il n’était pas porté atteinte au principe de non-rétroactivité « dès lors que le décret n'a pu avoir pour objet ou pour effet de remettre en cause des situations juridiques définitivement constituées, notamment les rémunérations de toutes natures dues au titre des services accomplis avant la date d'entrée en vigueur du décret » (C.E., 29 juillet 1994, nos 147467, 148217, 148226, 148243 et 148362, aux tables du Recueil Lebon).
– bouleverse des contrats légalement conclus avant son intervention, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État en considérant qu’« une disposition législative ou réglementaire nouvelle ne peut s'appliquer à des situations contractuelles en cours à sa date d'entrée en vigueur sans revêtir par là même un caractère rétroactif ; qu'il suit de là que, sous réserve des règles générales applicables aux contrats administratifs, seule une disposition législative peut, pour des raisons d'ordre public, fût-ce implicitement, autoriser l'application de la norme nouvelle à de telles situations » (C.E. Assemblée, 24 mars 2006, Société K.P.M.G., n° 288460, au Recueil Lebon).
2. Un principe aux tempéraments limités
Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs connaît des tempéraments.
Ainsi, l’administration peut déroger à ce principe :
– si elle y est autorisée par une loi ainsi que le prévoit l’article L. 221-4 du C.R.P.A. lui-même (pour une illustration : C.E., 30 décembre 1998, Société Entreprise Chagnaud S.A., n° 189315, aux tables du Recueil Lebon) ;
– pour tirer les conséquences d'une annulation juridictionnelle qui peut entraîner d’importants effets pour le passé en termes de reconstitution de carrière (C.E., 26 décembre 1925, Rodière, n° 88369, au Recueil Lebon) ou pour tirer les conséquences du retrait d’un acte administratif entaché d’illégalité ;
– en raison du fait que l’acte vient s’ajouter à des mesures antérieures dont il conditionne l’application (C.E., 9 décembre 1994, Assemblée des présidents des conseils généraux de France, nos 149545 et 149546, aux tables du Recueil Lebon : la décision portant agrément d’une convention peut légalement rétroagir à la date de signature de cette convention) ;
– pour régulariser la situation administrative d'un agent afin de le placer dans une position régulière pour combler un vide juridique. À cet égard, il a été jugé « que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir ; que, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires (…), l'administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation » (C.E., 17 mars 2004, n° 225426, aux tables du Recueil Lebon ; également : C.E., 14 juin 2010, n° 318712, aux tables du Recueil Lebon).
B. L’exigence de mesures transitoires au service de la sécurité juridique
L’article L. 221-2 du C.R.P.A. prévoit qu’« un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités [adéquates de publicité], sauf à ce qu’il en soit disposé autrement par la loi, par l’acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement », précisant toutefois que « l’entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures ». L’article L. 221-3 du même code comprend des dispositions du même ordre pour les actes réglementaires qui font l’objet d’une publication au Journal officiel de la République française puisqu’il prévoit que ces actes entrent en vigueur « dans les conditions prévues à l’article 1er du code civil7, à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Il en va différemment, ainsi que le prévoit ce même article, en cas d'urgence ou lorsque des mesures d'application sont nécessaires à l'exécution du texte ».
Pour éviter une entrée en vigueur trop abrupte d’une nouvelle réglementation, le C.R.P.A. comporte également des dispositions relatives aux conditions et aux modalités suivant lesquelles l’administration est tenue de prévoir des mesures transitoires.
.
L’article L. 221-5 de ce code dispose que : « L'autorité administrative investie du pouvoir réglementaire est tenue, dans la limite de ses compétences, d'édicter des mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6 lorsque l'application immédiate d'une nouvelle réglementation est impossible ou qu'elle entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. / Elle peut également y avoir recours, sous les mêmes réserves et dans les mêmes conditions, afin d'accompagner un changement de réglementation. »
L’article L. 221-6 donne une typologie, certes indicative et non exhaustive mais très pratique, en indiquant que : « Les mesures transitoires mentionnées à l'article L. 221-5 peuvent consister à : / 1° Prévoir une date d'entrée en vigueur différée des règles édictées ; / 2° Préciser, pour les situations en cours, les conditions d'application de la nouvelle réglementation ; / 3° Énoncer des règles particulières pour régir la transition entre l'ancienne et la nouvelle réglementation. »
Ces dispositions législatives sont directement inspirées, sans toutefois reprendre les termes de « sécurité juridique », de la jurisprudence selon laquelle : « Une réglementation nouvelle a, en principe, vocation à s'appliquer immédiatement, sous réserve (…) de l'obligation qui incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire, agissant dans les limites de sa compétence et dans le respect des règles qui s'imposent à elle, d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, cette réglementation nouvelle. Il en va ainsi lorsque l'application immédiate [de celle-ci] entraîne, au regard de leur objet et de leurs effets, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause » (C.E. Section, n° 287845, susmentionnée) ou « à des situations contractuelles en cours qui ont été légalement nouées » (C.E. Assemblée, n° 288460, susmentionnée).
De telles mesures transitoires doivent ainsi être prévues dans le cas d'une réforme substantielle d'un concours qui demande un long travail de préparation aux épreuves (C.E., 25 juin 2007, Syndicat C.F.D.T. du ministère des affaires étrangères, n° 304888, au Recueil Lebon).
Le juge administratif vérifie non seulement l’existence de mesures transitoires lorsque celles-ci sont nécessaires, mais également que ces mesures sont suffisantes (C.E., 17 juin 2015, Syndicat national des industries des peintures, enduits et vernis et Association française des industries, colles, adhésifs et mastics, n° 375853, au Recueil Lebon, considérant 18). S’il est attentif à l’existence d’un délai suffisant pour permettre aux acteurs concernés par une mesure de s’adapter à une nouvelle réglementation, le juge administratif tient toutefois également compte des impératifs liés à l’intérêt public, par exemple, des impératifs de santé publique qui peuvent justifier une application rapide de la nouvelle réglementation (C.E., 19 mars 2007, n° 300467, au Recueil Lebon).
II. LA SORTIE DE VIGUEUR DES ACTES ADMINSTRATIFS UNILATÉRAUX
Un acte administratif cesse d'être en vigueur :
– s'il devient caduc8 ;
– s'il est annulé à la suite d'une décision juridictionnelle ;
– s'il est retiré (= rapporté) ou abrogé par l'administration.
Sur ce dernier point, l’article L. 240-1 du C.R.P.A. précise qu’on entend par :
– Abrogation d’un acte : sa disparition juridique pour l’Avenir ;
– Retrait d’un acte : sa disparition juridique pour l’avenir et pour le passé (effet Rétroactif). Autrement dit, l’acte retiré (ou rapporté) disparaît de l’ordonnancement juridique depuis l’origine.
Les règles applicables au retrait et à l’abrogation, en grande partie d’origine prétorienne, étaient devenues au fil du temps subtiles et complexes à démêler.
Par plusieurs dispositions et avec le souci d’un équilibre entre le principe de légalité et le principe de sécurité juridique, le C.R.P.A. simplifie et clarifie le régime juridique applicable au retrait et à l’abrogation des actes administratifs unilatéraux, même s’il ne répond pas à toutes les questions dont certaines demeurent réglées par la jurisprudence, comme celle de l’autorité compétente pour retirer ou abroger un acte. Sur ce point, il a été jugé qu’« en principe, l'autorité administrative compétente pour modifier, abroger ou retirer un acte administratif est celle qui, à la date de la modification, de l'abrogation ou du retrait, est compétente pour prendre cet acte et, le cas échéant, s'il s'agit d'un acte individuel, son supérieur hiérarchique » (C.E. Section, 30 septembre 2005, n° 280605, au Recueil Lebon).
.
Cette disposition figure au chapitre 1er du titre IV du C.R.P.A. consacré à la sortie de vigueur des actes administratifs. Elle s’inspire de la décision par laquelle il a été jugé que « si un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits9 et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré, il incombe à l'ensemble des autorités administratives de tirer, le cas échéant, toutes les conséquences légales de cet acte aussi longtemps qu'il n'y a pas été mis fin ». (C.E. Section, 29 novembre 2002, Assistance publique – Hôpitaux de Marseille, n° 223027, au Recueil Lebon ; pour une illustration : C.E., 23 février 2009, n° 310277, aux tables du Recueil Lebon : « Le Conseil national des universités, compétent pour prendre la décision d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, est également compétent pour retirer cette décision. En l'espèce, retrait pour fraude, la thèse de l'intéressée, prise en considération pour son inscription sur cette liste, comportant des emprunts nombreux et manifestes à une autre thèse, sans les citations appropriées. »)
Les deux chapitres suivants de ce même titre IV du code ne retiennent pas la summa divisio classique distinguant le retrait et l’abrogation, mais une distinction entre les actes individuels créateurs de droits (A) et les actes non créateurs de droits, qu’ils soient réglementaires ou non réglementaires (B), les règles générales prévues en la matière s’appliquant « sous réserve des exigences découlant du droit de l’Union européenne10 et de dispositions législatives et réglementaires contraires » (article L. 241-1 du C.R.P.A.).
A. Les actes individuels créateurs de droits
Les règles applicables aussi bien au retrait qu’à l’abrogation des décisions individuelles créatrices de droits diffèrent en fonction de la personne qui est à l’initiative du retrait ou de l’abrogation, c’est-à-dire l’administration ou un tiers (1) ou le bénéficiaire de l’acte lui-même (2).
Enfin, le C.R.P.A. prévoit une règle particulière à l’abrogation et au retrait d’une décision individuelle créatrice de droits qui fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire (3).
1. Le retrait et l’abrogation des actes individuels créateurs de droits, à l’initiative de l’administration ou sur demande d’un tiers
Les décisions par lesquelles l’administration retire ou abroge une décision créatrice de droits doivent être motivées (article L. 211-2 du C.R.P.A.).
a. Un principe : un retrait ou une abrogation possible dans le délai de quatre mois (article L. 242-1)
L’article L. 242-1 du C.R.P.A. prévoit que : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale11 et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. »
La prise de la décision s’entend de la signature de l’acte et la décision de retrait doit être prise avant l’expiration du délai de quatre mois imparti à partir de cette date, la notification de cette décision de retrait pouvant en revanche intervenir après l’expiration de ce délai (C.E. Section, 21 décembre 2007, Société Bretim, n° 285515, au Recueil Lebon).
Pour le retrait, le C.R.P.A. procède ainsi à la codification de la décision Ternon par laquelle le Conseil d’État avait jugé que « sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision » (C.E. Assemblée, 26 octobre 2001, n° 197018, au Recueil Lebon)
12.
Au sujet de l’articulation de cette décision Ternon désormais codifiée avec les dispositions du premier alinéa de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, aux termes desquelles : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive », le Conseil d’État a rendu un avis selon lequel « une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée » (C.E., avis, 28 mai 2014, n° 376501, au Recueil Lebon).
Pour l’abrogation, le C.R.P.A. procède à la codification de la décision de Section n° 306084 du 6 mars 2009, publiée au Recueil Lebon, par laquelle le Conseil d’État avait étendu à l’abrogation la solution dégagée dans la décision Ternon pour le retrait en jugeant que « sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de cette décision et si elle est illégale ».
En outre, l’article L. 242-1 du C.R.P.A. simplifie le dispositif par une disposition applicable aussi bien aux décisions explicites ou expresses qu’implicites, mettant ainsi fin, en ce qui concerne les décisions implicites, à un état du droit qui était devenu peu accessible, mêlant dispositions législatives pour les décisions implicites d’acceptation13 et règles jurisprudentielles pour les décisions implicites de rejet14 .
b. Deux dérogations : l’abrogation d’une décision conditionnelle et le retrait d’une décision accordant une subvention sont possibles à tout moment (article L. 242-2)
L’article L. 242-2 du C.R.P.A. prévoit que : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie ; / 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées. »
– Pour l’abrogation d’une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie, l’article L. 242-2 s’inspire de la décision selon laquelle : « L'autorité compétente peut supprimer pour l'avenir un avantage dont le maintien est subordonné à une condition dès lors que celle-ci n'est plus remplie » (C.E. Section, n° 223041, susmentionnée).
Par exemple, il a été jugé que « le caractère créateur de droits de l'attribution d'un avantage financier tel qu'une prime ne fait pas obstacle à ce que cette décision soit abrogée pour l'avenir si l'intéressé ne remplit plus les conditions auxquelles cet avantage est subordonné ou si l'administration modifie l'appréciation qui avait justifié son attribution » (C.E., 27 juillet 2005, n° 270487, aux tables du Recueil Lebon).
Par ailleurs, le Conseil d’État a jugé en matière de protection fonctionnelle que lorsque celle-ci a été accordée, l’administration peut y mettre fin « pour l'avenir [si elle] constate postérieurement, sous le contrôle du juge, l'existence d'une faute personnelle », mais « qu'en revanche, le caractère d'acte créateur de droits de la décision accordant la protection de l'État fait obstacle à ce qu'[elle] puisse légalement retirer, plus de quatre mois après sa signature, une telle décision, hormis dans l'hypothèse où celle-ci aurait été obtenue par fraude » (C.E. Section, 14 mars 2008, n° 283943, au Recueil Lebon).
– Pour le retrait d’une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées, l’article L. 242-2 s’inspire de la jurisprudence selon laquelle « l'attribution d'une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire ; [mais] (…) toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention » (C.E., 5 juillet 2010, n° 308615, au Recueil Lebon).
En matière de subvention, le Conseil d’État a eu l’occasion de juger que « le caractère créateur de droits de l'attribution d'un avantage financier tel qu'une subvention ne fait pas obstacle soit à ce que la décision d'attribution soit abrogée si les conditions auxquelles est subordonnée cette attribution ne sont plus remplies, soit à ce que l'autorité chargée de son exécution, constatant que ces conditions ne sont plus remplies, mette fin à cette exécution en ne versant pas le solde de la subvention » (C.E., 7 août 2008, Crédit coopératif, n° 285979, au Recueil Lebon).
2. Le retrait et l’abrogation des actes individuels créateurs de droits sur demande du bénéficiaire
a. Une obligation de retrait ou d’abrogation dans le délai de quatre mois si l’acte est illégal (article L. 242-3)
L’article L. 242-3 du C.R.P.A. prévoit que : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration est tenue de procéder, selon le cas, à l'abrogation ou au retrait d'une décision créatrice de droits si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait peut intervenir dans le délai de quatre mois suivant l'édiction de la décision. »
Si l’acte est illégal, une obligation pèse donc sur l’administration de procéder à son retrait ou à son abrogation, dans la limite du délai de quatre mois.
Par cette disposition, le législateur s’inspire d’une règle jurisprudentielle en tenant compte de l’évolution intervenue entre temps par le découplage du délai de retrait et du délai de recours issu de la jurisprudence Ternonde 2001.
b. Une possibilité de retrait ou d’abrogation à tout moment d’un acte légal ou illégal (article L. 242-4)
L’article L. 242-4 du C.R.P.A. prévoit que : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire. »
– Si l’acte est illégal et que le délai de quatre mois dans lequel l’administration est tenue de retirer ou d’abroger une décision est dépassé, l’administration peut procéder à tout moment au retrait ou à l’abrogation d’un acte sur demande de son bénéficiaire, à condition toutefois de ne pas porter atteinte aux droits des tiers et de remplacer l’acte retiré ou abrogé par un acte plus favorable. Sur ce point, l’article L. 242-4 du C.R.P.A. peut être rapproché de la décision par laquelle il avait été jugé que « l'administration peut légalement retirer une décision individuelle créatrice de droit illégale sur demande du bénéficiaire au-delà du délai de quatre mois suivant son adoption dès lors qu'elle n'a pas créé de droit pour les tiers » (C.E., 13 novembre 2006, France Télécom, n° 270536, aux tables du Recueil Lebon).
– Si l’acte est légal, l’administration dispose de la même faculté (C.E. Section, 9 janvier 1953, n° 7562, Sieur Desfour, au Recueil Lebon), laquelle s’exerce sous les mêmes conditions d’absence d’atteinte aux droits des tiers et de prise d’une décision plus favorable issues d’une règle jurisprudentielle selon laquelle « en l'absence de dispositions législatives particulières, il résulte des règles générales applicables aux actes administratifs que l'auteur d'une décision individuelle expresse créatrice de droits peut, à la demande du bénéficiaire de cette décision, procéder à son retrait ou à son abrogation, à la condition de ne pas porter atteinte aux droits des tiers » (C.E., 2 février 2011, Société TV Numéric, n° 329254, au Recueil Lebon) et « pour lui substituer une décision plus favorable » (C.E., 29 octobre 2003, n° 241235, aux tables du Recueil Lebon et C.E., 26 septembre 2007, n° 290059, aux tables du Recueil Lebon).
3. Le retrait et l’abrogation d’un acte individuel créateur de droits qui fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire
Le C.R.P.A. comporte une disposition relative à l’abrogation et au retrait dans le cadre d’un recours administratif préalable qui permet à l’administration saisie d’un tel recours d’échapper au délai de quatre mois prévu à l’article L. 242-1.
En effet, l’article L. 242-5 du C.R.P.A. prévoit que : « Lorsque le recours contentieux à l'encontre d'une décision créatrice de droits est subordonné à l'exercice préalable d'un recours administratif et qu'un tel recours a été régulièrement présenté, le retrait ou l'abrogation, selon le cas, de la décision est possible jusqu'à l'expiration du délai imparti à l'administration pour se prononcer sur le recours administratif préalable obligatoire. » Cette disposition peut être rapprochée de celle de l’article 20-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui prévoyait en son deuxième alinéa que : « L'autorité administrative qui a pris la décision initiale peut la retirer d'office si elle est illégale tant que l'autorité chargée de statuer sur le recours administratif préalable obligatoire ne s'est pas prononcée. »
B. Les actes réglementaires et les actes non réglementaires non créateurs de droits
Le C.R.P.A. ne retient pas comme pour les actes créateurs de droits une distinction selon la personne à l’initiative de la demande de retrait ou d’abrogation, mais un régime juridique différent selon qu’il s’agit d’un retrait (1) ou d’une abrogation (2).
1. Le retrait des actes réglementaires ou non réglementaires non créateurs de droits
a. Un principe : un retrait possible dans le délai de quatre mois (article L. 243-3)
L’article L. 243-3 du C.R.P.A. prévoit que : « L'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction. »
Par cette disposition, le C.R.P.A. aligne le régime du retrait des actes non créateurs de droits sur celui du retrait ou de l’abrogation des actes créateurs de droits prévu à l’article L. 242-1 et met ainsi un terme à un état du droit qui était d’une grande complexité puisque :
– pour un acte réglementaire, le retrait était possible à tout moment et pour tout motif à la condition que l’acte n’ait reçu aucune application effective (C.E. Assemblée, 21 octobre 1966, nos 61851 et 61935, au Recueil Lebon). Puis le Conseil d’État avait jugé que : « Une autorité administrative peut légalement retirer un texte réglementaire illégal si le délai de recours contentieux n'est pas expiré au moment où elle édicte le retrait, ou si celui-ci a fait l'objet d'un recours gracieux ou contentieux formé dans ce délai » (C.E., 19 mars 2010, Syndicat des compagnies aériennes autonomes, n° 305047, aux tables du Recueil Lebon) ;
– pour un acte non réglementaire non créateur de droits, il avait été jugé que le retrait pouvait intervenir sans condition de délai et pour n’importe quel motif (C.E. Assemblée, 29 avril 1994, Association Unimate 65 et Société Sepanso Béarn, nos 112910 et 115044, au Recueil Lebon).
b. Une dérogation : le retrait d’une sanction est possible à tout moment (article L. 243-4)
L’article L. 243-4 du C.R.P.A. prévoit que « par dérogation à l’article L. 243-3, une mesure à caractère de sanction infligée par l'administration peut toujours être retirée ».
Le législateur s’inspire de la décision par laquelle il a été jugé « qu’une décision de sanction prise à l'encontre d'un agent public, qui fait seulement obstacle à ce qu'une sanction plus lourde puisse par la suite être infligée à l'intéressé en raison des mêmes faits, ne crée de droits acquis ni au profit de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, ni au profit des tiers ; qu'une telle décision peut, par suite, être légalement retirée à tout moment par son auteur » (C.E., 29 décembre 1999, n° 185005, au Recueil Lebon).
2. L’abrogation des actes règlementaires ou non réglementaires non créateurs de droits
a. Les actes légaux : une abrogation possible à tout moment (article L 243-1)
L’article L. 243-1 du C.R.P.A. prévoit que : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6 . ».
Par cette disposition, le C.R.P.A. rappelle qu’en vertu du principe de la mutabilité des actes administratifs, nul n’a de droit acquis au maintien d’un acte administratif (C.E. Section, 27 janvier 1961, Sieur Vannier, n° 38661, au Recueil Lebon). À cet égard, dans sa décision du 13 décembre 2006 (n° 287845, susmentionnée), le Conseil d’État a jugé que « l'exercice du pouvoir réglementaire implique pour son détenteur la possibilité de modifier à tout moment les normes qu'il définit sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes puissent invoquer un droit au maintien de la réglementation existante ».
Le C.R.P.A. précise également l’obligation pour l’administration de prévoir s’il y a lieu des mesures transitoires.
b. Les actes illégaux : une abrogation obligatoire (article L. 243-2)
Le C.R.P.A. distingue, sous la forme de deux alinéas différents à l’article L. 243-2, les actes réglementaires, d’une part, et les actes non réglementaires non créateurs de droits, d’autre part.
Pour les actes réglementaires, le premier alinéa de l’article L. 243-2 du C.R.P.A. prévoit que : « L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. »
Cette disposition est la reprise de l’article 16-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui avait été créé par la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit et aux termes duquel : « L'autorité compétente est tenue, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, d'abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. »
Cette disposition législative était elle-même le résultat de la codification de la décision Compagnie Alitalia par laquelle il avait été jugé que « l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenu d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date » (C.E. Assemblée, 3 février 1989, n° 74052, au Recueil Lebon).
En obligeant l’administration à procéder à une abrogation « sauf à ce que l’illégalité ait cessé », l’article L. 242-2 du C.R.P.A. intègre sur ce point une précision apportée en 2013 par le Conseil d’État qui a jugé « que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que, toutefois, cette autorité ne saurait être tenue d'accueillir une telle demande dans le cas où l'illégalité du règlement a cessé, en raison d'un changement de circonstances, à la date à laquelle elle se prononce » (C.E., 10 octobre 2013, Fédération française de gymnastique, n° 359219, au Recueil Lebon).
Pour les actes non réglementaires, le second alinéa de l’article L. 243-2 du C.R.P.A. prévoit que : « L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. »
À la différence des actes réglementaires, cette obligation d’abroger ne vaut pas si l’acte est illégal depuis l’origine, mais vaut uniquement si l’illégalité ou la perte d’objet résulte de faits postérieurs à l’édiction de l’acte.
De ce point de vue, le C.R.P.A. procède à la codification des principes dégagés par la jurisprudence selon laquelle « il appartient à tout intéressé de demander à l'autorité compétente de procéder à l'abrogation d'une décision illégale non réglementaire qui n'a pas créé de droits si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction » (C.E. Section, 30 novembre 1990, Association "Les Verts", n° 103889, au Recueil Lebon).
En outre, le second alinéa de l’article L. 243-2 intègre en l’étendant aux actes non réglementaires la précision apportée par le Conseil d’État en 2013 sur la cessation de l’illégalité mettant fin à l’obligation d’abroger l’acte (C.E., n° 359219, susmentionnée).
La codification par le C.R.P.A. de règles dégagées par la jurisprudence administrative ne se limite pas à l’entrée et la sortie de vigueur des actes administratifs15.
.
Mais l’entrée et la sortie de vigueur des actes administratifs unilatéraux se singularisent dans la mesure où le Gouvernement ne s’est pas contenté de codifier à droit constant, à « jurisprudence constante », mais s’est employé à simplifier le dispositif issu de la jurisprudence en matière de retrait et d’abrogation.
À cet égard, le Conseil d’État relève d’ailleurs dans son étude annuelle 2016 (p. 102) que « la simplification gagnera (…) à s’appuyer sur la codification avec laquelle elle entretient des relations étroites (…) ».
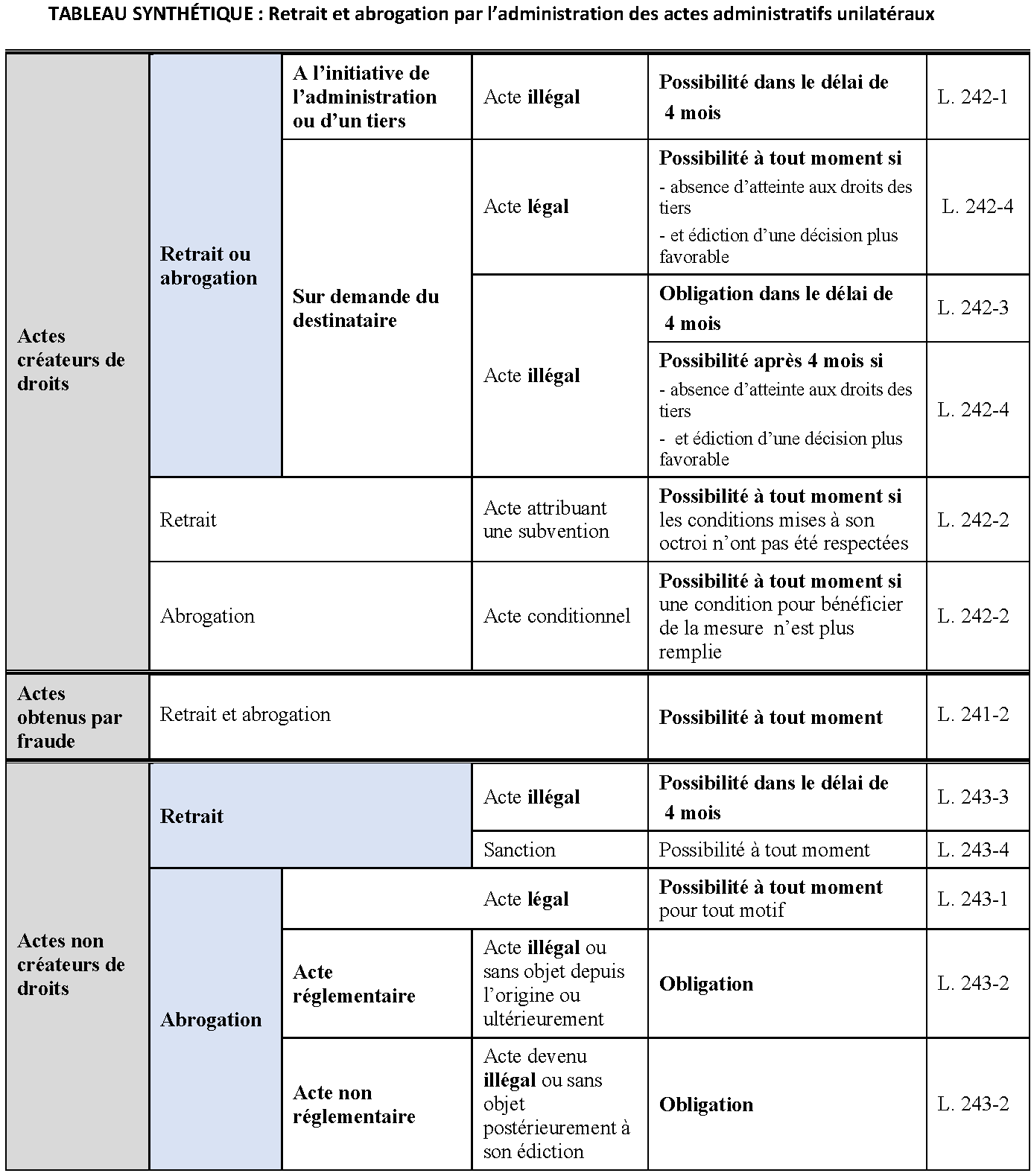 
Cédric Benoit
NOTES
2. Créé par l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration et par le décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif aux dispositions réglementaires du même code, le C.R.P.A. a été complété par l'ordonnance n° 2016-307 du 17 mars 2016 portant codification des dispositions relatives à la réutilisation des informations publiques et le décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 relatif à la réutilisation des informations publiques et modifiant le code des relations entre le public et l'administration.
Les dispositions du C.R.P.A. ont par la suite été complétées ou modifiées par plusieurs textes législatifs et réglementaires : la loi n° 2015-1713 du 22 décembre 2015 portant dématérialisation du Journal officiel de la République française et le décret n° 2015-1717 du 22 décembre 2015 relatif au même objet, le décret n° 2016-1036 du 28 juillet 2016 relatif aux principes et aux modalités de fixation des redevances de réutilisation des informations du secteur public, la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, le décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016 relatif aux modalités de saisine de l’administration par voie électronique, le décret n° 2016-1564 du 21 novembre 2016 relatif aux délégations accordées par la commission d'accès aux documents administratifs à son président, le décret n° 2016-1617 du 29 novembre 2016 relatif aux catégories d'informations publiques de l'État et de ses établissements publics administratifs susceptibles d'être soumises au paiement d'une redevance de réutilisation, le décret n° 2016-1922 du 28 décembre 2016 relatif à la publication en ligne des documents administratifs, la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique (article 4), le décret n° 2017-331 du 14 mars 2017 relatif au service public de mise à disposition des données de référence, le décret n° 2017-349 du 20 mars 2017 relatif à la procédure d’accès sécurisé aux bases de données publiques. [retour]
3. L’article L. 212-1 du C.R.P.A. prévoit que « toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci », mais ces dispositions « n'ont ni pour objet, ni pour effet d'imposer que toute décision prise par [l]es autorités administratives prenne une forme écrite » (C.E., 12 octobre 2016, n° 395307, aux tables du Recueil Lebon). [retour]
4. En revanche, un acte individuel défavorable, source d’obligations pour son destinataire, n’est opposable qu’en conséquence de sa notification (C.E., 28 octobre 1988, nos 49432 et 49433, aux tables du Recueil Lebon). [retour]
5. Rappelant que « les conditions de publication d'un acte sont en principe sans influence sur sa légalité », le Conseil d’État précise toutefois qu’« il en va autrement lorsque l'acte détermine lui-même la date de son entrée en vigueur. Dans cette hypothèse, l'acte n'entre légalement en vigueur à la date qu'il prévoit que si les conditions de sa publication le permettent effectivement » (C.E., 24 février 1999, n° 188154, au Recueil Lebon). [retour]
6.Ce principe ne s’applique pas aux contrats administratifs puisqu’« aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu'aucun principe général du droit, ne fait obstacle à ce que des stipulations d'un contrat produisent des effets rétroactifs entre les parties, à condition que ces effets ne s'étendent pas à des personnes qui ne seraient pas parties au contrat » (C.E. Section, 19 novembre 1999, n° 1766261, au Recueil Lebon). [retour]
7. Aux termes de l’article 1er du code civil : « Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. / En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels. » [retour]
8. La caducité peut résulter d'une durée de vie limitée dans le temps prévue par le texte lui-même (péremption du texte) ou de la disparition des situations qu’entendait régir un acte ainsi dépourvu de toute application (C.E., 12 mars 2014, Comité Harkis et Vérité et M. X, n° 353066, aux tables du Recueil Lebon). [retour]
9. Cette précision n’est pas reprise par l’article L. 241-2 qui règle la question du retrait et de l’abrogation des actes obtenus par fraude sans qu’il soit utile de savoir si ces actes sont ou non créateurs de droits. [retour]
10. Ainsi, il a été jugé que « lorsqu'est en cause la légalité d'une décision de récupération d'une aide indûment versée en application d'un texte communautaire, il y a lieu de vérifier d'abord si une disposition communautaire définit les modalités de récupération de cette aide. Dans la négative, il y a lieu de se référer aux règles de droit national et d'apprécier si ces dernières doivent, pour le règlement du litige, être écartées ou interprétées, afin que la pleine efficacité du droit communautaire soit assurée. En l'espèce, en l'absence de disposition communautaire, les règles nationales relatives aux modalités de retrait des décisions créatrices de droits étaient applicables et il y a lieu de les interpréter comme ne pouvant faire obstacle au reversement de l'aide litigieuse que si le bénéficiaire a été de bonne foi » (C.E., 28 octobre 2009, Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, n° 302030, au Recueil Lebon). [retour]
11. L’administration ne peut d’elle-même abroger une décision individuelle créatrice de droits qui est légale. Il a été jugé que « l'autorité administrative ne peut abroger une décision non réglementaire créatrice de droits, en l'absence de demande en ce sens du titulaire des droits, que dans les cas prévus par les lois et règlements en vigueur » (C.E., 30 juin 2006, Société Neuf Télécom, n° 289564, au Recueil Lebon). [retour]
12. Par cette décision Ternon de 2001, le Conseil d’État avait dissocié le délai de retrait du délai de recours contentieux mettant ainsi un terme à la décision Dame Cachet n° 74010 du 3 novembre 1922, publiée au Recueil Lebon, qui avait couplé les deux délais posant le principe selon lequel le retrait était possible tant que le délai de recours contentieux n’était pas expiré et, si un tel recours avait été formé, pendant toute la durée de l’instance. [retour]
13. Pour les décisions implicites d’acceptation, l’article 23 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 prévoyait qu’« une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : / 1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en œuvre ; / 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en œuvre ; / 3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé ».
Au sujet de cet article, le Conseil d’État avait jugé qu’« il résulte de l'économie générale de cet article que son 3° permet à l'administration de retirer, pour illégalité, une décision implicite d'acceptation, que des mesures d'information des tiers aient été ou non mises en œuvre à la suite de l'intervention de cette décision, dès lors que l'annulation de cette décision a été demandée au juge, et tant que celui-ci n'a pas statué. Par suite, alors même qu'aucune mesure d'information des tiers n'aurait été mise en œuvre, le retrait de la décision attaquée est possible après l'expiration du délai de deux mois mentionné au 2° de l'article 23 dès lors qu'un recours contentieux a été formé » (C.E., 12 octobre 2006, n° 292263, au Recueil Lebon).
Ce dispositif législatif avait mis fin à une jurisprudence selon laquelle le Conseil d’État avait exclu, pour les décisions implicites d’acceptation n’ayant pas fait l’objet de mesures de publicité à l’égard des tiers, toute possibilité de retrait dès la formation de la décision (C.E. Section, 14 novembre 1969, n° 74930, au Recueil Lebon). [retour]
14. Pour les décisions implicites de rejet, par une décision dans la lignée de la décision Dame Cachet de 1922, il avait été jugé que « l'autorité administrative peut légalement, dans le délai de recours contentieux, rapporter une décision implicite de rejet illégale créatrice de droits » (C.E., 26 janvier 2007, S.A.S. Kaefer Wanner, n° 284605, au Recueil Lebon). Par une décision du 17 octobre 2016, le Conseil d’État a marqué la fin de cette jurisprudence de 2007 en jugeant que « s'agissant des refus implicites nés avant l'entrée en vigueur, le 1er juin 2016, de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, le ministre peut, par une décision expresse prise dans le délai de recours contentieux contre cette décision de rejet, retirer sa décision implicite de rejet si celle-ci est illégale et faire droit au recours hiérarchique par une décision expresse » (C.E., 17 octobre 2016, n° 389092). [retour]
15. Voir, par exemple, l’article L. 411-2 du C.R.P.A. qui, après avoir indiqué que « toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai », prévoit que « lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ».
Cette disposition législative reprend ainsi le considérant de principe d’une décision du Conseil d’État du 7 octobre 2009 (C.E., 7 octobre 2009, n° 322581, au Recueil Lebon) selon lequel « lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre d'une décision administrative sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ».
Voir également, pour une autre illustration, l’article L. 122-2 du C.R.P.A. qui dispose que « les mesures (…) à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ». Cette disposition s’inspire de la décision du 30 janvier 2012 (Ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, n° 349009, aux tables du Recueil Lebon) par laquelle le Conseil d’État a jugé que « le respect du principe général des droits de la défense implique que la personne concernée, après avoir été informée des griefs formulés à son encontre, soit mise à même de demander la communication de son dossier et dispose de la faculté de pouvoir présenter utilement ses observations avant que l'autorité disposant du pouvoir de sanction se prononce ». [retour]
|
| |
TEXTES OFFICIELS
Enseignement : questions générales
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Citoyenneté
 Réserve civique et réserve citoyenne de l’éducation nationale Réserve civique et réserve citoyenne de l’éducation nationale
Décret n° 2017-930 du 9 mai 2017 relatif à la réserve civique
J.O.R.F. du 10 mai 2017
Pris en application de l’article 8 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté qui renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les modalités d’application de ses articles 1er à 5 et 7 (cf. signalement de cette loi dans la rubrique « Actualités » de la LIJ n° 197 de mars 2017), le décret du 9 mai 2017 relatif à la réserve civique précise le contenu de la charte de la réserve civique, définit l’autorité de gestion de la réserve civique et ses compétences, ainsi que les modalités d’inscription des réservistes.
L’article 11 du décret prévoit que la réserve citoyenne de l’éducation nationale, réserve thématique désormais intégrée à la réserve civique, obéit à des règles d’organisation particulières qui dérogent à la plupart de ses dispositions : cet article indique en effet que les dispositions du chapitre Ier du décret (ensemble des règles générales applicables à la réserve civique) ne sont pas applicables à la réserve citoyenne de l’éducation nationale, à l’exception de son article 1er relatif à la charte de la réserve civique, laquelle est annexée au décret, et il précise que l’autorité de gestion de la réserve citoyenne de l’éducation nationale est le recteur d’académie.
Le chapitre III du décret du 9 mai 2017 procède notamment aux adaptations nécessaires à son application outre-mer (cf. article 14) : désignation de l’autorité de gestion de la réserve civique en Outre-mer, inapplicabilité en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de l’article 11 du décret relatif à la réserve citoyenne de l’éducation nationale.
La charte de la réserve civique annexée au décret énonce, conformément à l’article 1er de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté, les principes directeurs de la réserve civique, ainsi que les engagements et les obligations des réservistes et des organismes d’accueil. 
Enseignement scolaire
QUESTIONS GÉNÉRALES
Organisation de l’enseignement scolaire
 Écoles maternelles et élémentaires publiques – Rythmes scolaires – Organisation de la semaine scolaire – Possibilité de prolonger d’une année les adaptations de la semaine scolaire mises en place par dérogation ou dans le cadre de l’expérimentation prévue par le décret du 7 mai 2014 Écoles maternelles et élémentaires publiques – Rythmes scolaires – Organisation de la semaine scolaire – Possibilité de prolonger d’une année les adaptations de la semaine scolaire mises en place par dérogation ou dans le cadre de l’expérimentation prévue par le décret du 7 mai 2014
Décret n° 2017-549 du 14 avril 2017 modifiant le décret n° 2016-1049 du 1er août 2016 autorisant des dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques
J.O.R.F. du 16 avril 2017
Le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires a modifié l’organisation de la semaine scolaire des élèves des écoles publiques du premier degré à partir de la rentrée 2013, en modifiant les articles D. 521-10 et suivants du code de l’éducation. Si le décret a maintenu les vingt-quatre heures d’enseignement hebdomadaires résultant de la réforme de 2008, il a modifié l’article D. 521-10 pour prévoir qu’elles sont réparties sur neuf demi-journées. Cet article précise que les heures d’enseignement sont organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi matin, à raison de cinq heures trente maximum par jour et de trois heures trente maximum par demi-journée avec une pause méridienne dont la durée ne peut être inférieure à une heure trente.
Ce décret a toutefois prévu que l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale (I.A.-DASEN), pourrait accorder pour une durée maximale de trois ans, à la demande du conseil d’école ou de la commune siège de l’école, des dérogations portant sur l’organisation de la neuvième demi-journée d’enseignement (dans la pratique, le samedi matin au lieu du mercredi matin) ou sur les maxima horaires de la journée ou de la demi-journée, après s’être assuré que ces dérogations sont justifiées par les particularités du projet éducatif territorial et que l’organisation de la semaine scolaire proposée présente des garanties pédagogiques suffisantes.
Puis le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014, entré en vigueur à la rentrée scolaire 2014, a permis au recteur d’académie d’autoriser, à titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, des adaptations plus importantes de l’organisation de la semaine scolaire à la condition qu’elles n’aient pas pour effet de répartir les enseignements sur moins de huit demi-journées par semaine, comprenant au moins cinq matinées, ni d’organiser les heures d’enseignement sur plus de vingt-quatre heures hebdomadaires, ni sur plus de six heures par jour et trois heures trente par demi-journée. Ces demandes d’expérimentations devaient être présentées conjointement par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) intéressé et un ou plusieurs conseils d’école, étant précisé que si une majorité des conseils d’école d’une commune s’était exprimée en faveur d’une expérimentation, le recteur pouvait décider qu’elle s’appliquerait à toutes les écoles de la commune. Ces expérimentations devaient faire l’objet d’une évaluation six mois avant leur terme.
Les dispositions à caractère expérimental du décret du 7 mai 2014 ont été introduites dans le droit commun tel qu’il est fixé par les articles D. 521-10 et suivants du code de l’éducation par le décret n° 2016-1049 du 1er août 2016 et c’est désormais l’I.A.-DASEN qui peut autoriser les deux formes de dérogations à l’organisation de la semaine scolaire telles qu’elles avaient été prévues par le décret de janvier 2013, puis par le décret de mai 2014.
Alors que la période de trois ans pour laquelle des dérogations à l’organisation de la semaine scolaire ont été accordées à partir de l’année scolaire 2014-2015 – d’une part, sur le fondement de l’article D. 521-12 du code de l’éducation (dans sa version issue du décret du 24 janvier 2013) et, d’autre part, dans le cadre des expérimentations prévues par le décret du 7 mai 2014 – va s’achever à la fin de l’année scolaire 2016-2017, elles n’ont pas toutes fait l’objet d’une évaluation.
C’est pourquoi le décret n° 2017-549 du 14 avril 2017 prévoit que l’autorité académique (recteur d’académie pour les dérogations expérimentées sur le fondement du décret du 7 mai 2014 et I.A.-DASEN pour les dérogations accordées sur le fondement de l’article D. 521-12 dans sa rédaction issue du décret du 24 janvier 2013), si elle est saisie d’une demande en ce sens du maire de la commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale intéressé, peut prolonger d’une année les adaptations à l’organisation de la semaine scolaire qu’elle a accordées lorsque cette période complémentaire paraît nécessaire pour procéder à leur évaluation. 
Enseignement supérieur et recherche
ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Questions communes
 Élections – Établissements d’enseignement supérieur – Universités Élections – Établissements d’enseignement supérieur – Universités
Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives aux médiateurs et aux conditions d'exercice du droit de suffrage, à la composition des collèges électoraux et aux modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique culturel et professionnel
J.O.R.F. du 25 avril 2017
Ce décret du 24 avril 2017 modifie les dispositions du code de l’éducation relatives aux élections des représentants des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Il a pour objet d’améliorer la participation des usagers et des personnels aux élections organisées dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et de préciser l'organisation des opérations électorales afin de garantir la sécurité juridique de ces élections. Il précise notamment la composition et le rôle du comité électoral consultatif qui assiste le président ou le directeur de l'établissement responsable de l'organisation des élections et les modalités selon lesquelles sont établies les procurations.
Il étend également la compétence des médiateurs académiques aux opérations électorales décrites aux articles D. 719-1 à D. 719-37 du code de l'éducation.
Les dispositions du décret s'appliquent aux élections des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont les modalités d'organisation sont fixées par une décision prise postérieurement au 1er juillet 2017. 
ÉTUDES
Inscription des étudiants
 Inscription des étudiants – Sections de techniciens supérieurs – Bacheliers professionnels – Expérimentation Inscription des étudiants – Sections de techniciens supérieurs – Bacheliers professionnels – Expérimentation
Décret n° 2017-515 du 10 avril 2017 portant expérimentation de modalités d’admission dans une section de techniciens supérieurs pour les titulaires d’un baccalauréat professionnel
Arrêté du 10 avril 2017 pris en application de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté pour fixer les régions académiques dans lesquelles est conduite l’expérimentation de modalités d’admission dans une section de techniciens supérieurs pour les titulaires d’un baccalauréat professionnel
J.O.R.F. du 12 avril 2017
1. Ce décret du 10 avril 2017 a pour objet de mettre en œuvre l’article 40 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté qui prévoit l’expérimentation pendant trois ans d’une procédure d’admission de bacheliers professionnels dans une section de techniciens supérieurs (STS) sur avis rendu par le conseil de classe de leur établissement d'origine pour chaque spécialité de STS demandée au cours de la procédure d'orientation par les candidats au baccalauréat professionnel ou les titulaires récents de ce diplôme.
L’expérimentation organisée par le décret permet aux recteurs d'académie dans les régions académiques dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur d'admettre dans une section de techniciens supérieurs de l'enseignement public les titulaires d'un baccalauréat professionnel, après avis d'orientation favorable émis par le conseil de classe du deuxième trimestre ou du premier semestre de terminale professionnelle, sous réserve de l’obtention du baccalauréat professionnel. Il fixe la procédure à suivre si le nombre d’avis favorables d’orientation excède le nombre de places de chaque section de techniciens supérieurs offertes aux candidats. Il permet aux étudiants qui, bien qu’ayant obtenu un avis favorable d’orientation, ne reçoivent pas de proposition d’admission dans une section de techniciens supérieurs de l’enseignement public de participer à cette procédure la ou les deux années suivantes.
Le texte prévoit une évaluation du dispositif à partir des bilans annuels établis par les recteurs des régions académiques dans lesquelles se déroule l’expérimentation.
2. L’arrêté du 10 avril 2017 fixe la liste des régions académiques dans lesquelles cette expérimentation est conduite : Bourgogne – Franche-Comté, Bretagne et Hauts-de-France. 
 Procédures d’admission en première année de licence ou en première année commune aux études de santé Procédures d’admission en première année de licence ou en première année commune aux études de santé
Circulaire n° 2017-077 du 24 avril 2017 prise en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 612-3 du code de l’éducation
B.O.E.N. n° 17 du 27 avril 2017
Prise pour l’application du deuxième alinéa de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, la circulaire ministérielle du 24 avril 2017 fixe l’ordre des critères pris en compte pour procéder au classement des candidats sollicitant une préinscription via le portail Admission Post-Bac (A.P.B.) en vue d’une admission en première année de licence ou en première année commune aux études de santé (PACES) lorsque le total des candidats excède les capacités d’accueil d’une formation de première année de licence ou de PACES définies par le président de l’établissement.
A - Sont tout d'abord classés les candidats résidant ou ayant obtenu le baccalauréat ou son équivalent dans l'académie du siège ou du site de l'établissement proposant la formation concernée.
1. Ces candidats sont classés selon la priorité qu'ils ont accordée à cette formation parmi l'ensemble des vœux de première année de licence ou de PACES qu'ils ont formulés lors de la procédure de préinscription.
2. Les candidats ayant obtenu le même classement à l'issue de cette première phase sont départagés par un second classement en fonction de la priorité qu'ils ont accordée à cette formation parmi l'ensemble des vœux qu'ils ont formulés lors de la procédure de préinscription.
3. Si, à l'issue de l'examen des deux précédents critères, il reste des candidats ayant le même rang de classement, une priorité est accordée à ceux d'entre eux qui sont mariés, ont conclu un pacte civil de solidarité, vivent en concubinage, ou ont une ou plusieurs personnes à charge.
B - Il est ensuite procédé au classement des candidats ne résidant pas et n'ayant pas obtenu le baccalauréat ou son équivalent dans l'académie du siège ou du site de l'établissement proposant la formation concernée, selon les mêmes critères qu’au A, appréciés dans le même ordre.
C - Si, à l'issue du classement établi par application des critères mentionnés ci-dessus, la capacité d’accueil dans la formation de l’établissement considéré nécessite de départager des candidats ayant un même ordre de priorité, il est procédé à un tirage au sort. 
Enseignements et diplômes
 Modalités d’information des titulaires du diplôme national de licence qui ne souhaitent pas poursuivre leurs études en deuxième cycle Modalités d’information des titulaires du diplôme national de licence qui ne souhaitent pas poursuivre leurs études en deuxième cycle
Décret n° 2017-851 du 6 mai 2017 relatif aux modalités d’information des titulaires du diplôme national de licence sur les perspectives qui leur sont offertes en matière d’insertion professionnelle ou de poursuite de formation
J.O.R.F. du 10 mai 2017
Ce décret du 6 mai 2017 est pris en application du dernier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, qui fait obligation au service public de l’enseignement supérieur de délivrer une information relative à leurs perspectives d’insertion professionnelle ou de poursuite d’études aux étudiants titulaires du diplôme national de licence qui ne souhaitent pas poursuivre leurs études en deuxième cycle.
Il crée dans le code de l’éducation un article R. 612-32-6 qui prévoit que cette information leur est délivrée par l’université dans laquelle ils ont obtenu leur diplôme national de licence, dans les conditions définies par le président et au plus tard dans le délai de six mois qui suit la date d'obtention du diplôme.
Cet article nouveau du code précise que cette information, qui peut être délivrée aux étudiants de manière collective ou individuelle, le cas échéant par des moyens numériques, peut être assurée par les services universitaires chargés de l'information, de l'orientation et de l'insertion professionnelle des étudiants, notamment le bureau d'aide à l'insertion professionnelle mentionné à l'article L. 611-5, et que l'université peut associer des institutions partenaires compétentes en matière d'insertion professionnelle ou d'orientation.
L’article R. 612-32-6 nouveau du code précise enfin le contenu de cette information : elle porte sur les métiers et les professions auxquels ces titulaires du diplôme national de licence sont susceptibles d'accéder à raison des compétences et des connaissances qu'ils ont acquises, ainsi que sur les outils et techniques de recherche d'emploi. Elle porte également sur les formations qui peuvent leur être proposées par l'université ou par d'autres établissements. 
 Reconnaissance de l’engagement des étudiants dans la vie associative, sociale ou professionnelle Reconnaissance de l’engagement des étudiants dans la vie associative, sociale ou professionnelle
Décret n° 2017-962 du 10 mai 2017 relatif à la reconnaissance de l'engagement des étudiants dans la vie associative, sociale ou professionnelle
J.O.R.F. du 11 mai 2017
Le décret n° 2017-962 du 10 mai 2017, pris en application des articles L. 611-9 et L. 611-11 du code de l’éducation créés par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, remplace les articles D. 611-7 à D. 611-9 du code de l’éducation.
Il prévoit que les établissements d'enseignement supérieur doivent mettre en œuvre un dispositif garantissant la validation, pour l'obtention d'un diplôme, des compétences, connaissances et aptitudes acquises par leurs étudiants dans l'exercice des activités associatives, sociales ou professionnelles mentionnées à l'article L. 611-9 du code de l'éducation et qui relèvent de celles attendues dans leur cursus d’études.
Ces compétences, connaissances et aptitudes acquises dans l’exercice de ces activités par les étudiants sont validées, sur leur demande, notamment sous la forme de l’attribution d’éléments constitutifs d’une unité d’enseignement, de crédits du système européen d’unités d’enseignement capitalisables et transférables (E.C.T.S.), ou d’une dispense, totale ou partielle, de certains enseignements ou stages relevant du cursus de formation suivi. Les mêmes activités ne peuvent donner lieu qu’à une seule validation des compétences, connaissances et aptitudes acquises.
Les modalités de demande et de validation sont définies par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l’établissement d’enseignement supérieur dispensant la formation où est inscrit l’étudiant, ou, à défaut, par l’instance en tenant lieu. Elles doivent être fixées au plus tard deux mois après le début de l’année universitaire.
La validation s’accompagne d’une inscription dans l’annexe descriptive au diplôme ou de toute autre modalité déterminée par l’instance compétente pour définir ses modalités.
Le décret précise également les aménagements dans l’organisation et le déroulement des études et des examens, ainsi que les droits spécifiques dont peuvent bénéficier les étudiants qui le demandent pour leur permettre de concilier l’exercice des activités mentionnées à l’article L. 611-11 avec la poursuite de leurs études. Là encore, il appartient à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l’établissement d’enseignement supérieur dispensant la formation où est inscrit l’étudiant, ou, à défaut, à l’instance en tenant lieu, de définir, après une évaluation des besoins, les aménagements et droits spécifiques appropriés.
Le décret entre en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2017-2018. 
VIE ÉTUDIANTE
Bourses d’études et autres aides
 Aides aux étudiants – Grande École du numérique – Aides à la formation Aides aux étudiants – Grande École du numérique – Aides à la formation
Décret n° 2017-548 du 14 avril 2017 relatif à l’aide accordée aux personnes inscrites dans une formation labellisée par la Grande École du numérique
J.O.R.F. du 16 avril 2017
Ce décret du 14 avril 2017 crée une aide financière au bénéfice des personnes diplômées à la recherche d'un emploi ou en reconversion et des personnes dépourvues de qualification professionnelle ou d'un titre ou diplôme, qui sont inscrites dans une formation labellisée par la Grande École du numérique (GEN). Cette aide est attribuée sous les mêmes conditions de revenus que celles fixées pour l’attribution des bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Son montant est également fixé par référence aux taux des bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. L’aide est versée à compter du mois suivant celui où le demandeur a produit l’ensemble des documents nécessaires à l’instruction de sa demande et pour la durée de la formation. Elle n’est pas cumulable avec une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ou une aide spécifique versée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou les établissements publics qui en relèvent.
Le décret précise que sont exclues du bénéfice de l’aide les personnes qui perçoivent certaines aides financières : les personnes inscrites à Pôle emploi comme demandeurs d’emploi qui perçoivent une aide à l'insertion ou une aide à la formation professionnelle, les personnes rémunérées sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, les personnes qui perçoivent une aide d’une collectivité publique, les personnes percevant une aide du ministère chargé de l'emploi ou d'un conseil régional versée au titre de la formation professionnelle ou de l'insertion professionnelle, ou les personnes en congé individuel de formation.
La demande d’aide est déposée par voie électronique sur le site de la Grande École du numérique. La décision d'attribution de l'aide est prise, selon le cas, par le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires compétent ou par le vice-recteur de Mayotte. L'instruction et le paiement de l'aide sont réalisés par le réseau des œuvres universitaires et, à Mayotte, par le vice-recteur.
Le bénéficiaire de l'aide s'engage à suivre la formation au titre de laquelle l'aide lui a été attribuée et doit se soumettre aux conditions d'assiduité et de contrôle des connaissances prévues par la structure d'accueil en formation, sous peine de devoir reverser les sommes perçues.
L’article 14 du décret précise que les personnes qui, à la date de sa publication, sont inscrites dans une formation labellisée par la Grande École du numérique bénéficient de l'aide à compter du mois suivant celui où elles ont produit l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de leur demande, y compris au titre des mois de formation déjà écoulés. 
 Aide à la mobilité accordée aux étudiants inscrits en première année de master Aide à la mobilité accordée aux étudiants inscrits en première année de master
Décret n° 2017-969 du 10 mai 2017 relatif à l’aide à la mobilité accordée aux étudiants inscrits en première année du diplôme national de master
J.O.R.F. du 11 mai 2017
Ce décret du 10 mai 2017 institue une aide à la mobilité pour les étudiants bénéficiaires, au titre de l’inscription en première année de master, d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ou d'une allocation annuelle accordée dans le cadre du dispositif des aides spécifiques versées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou les établissements publics qui en relèvent, inscrits, l’année universitaire qui suit l’obtention de leur diplôme national de licence et pour la première fois, en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master dans une région académique différente de celle dans laquelle ils ont obtenu leur diplôme national de licence.
La demande d’aide, assortie de pièces justificatives, doit être déposée par voie électronique sur un portail numérique.
L'instruction, l'attribution et le paiement de l'aide sont réalisés par le réseau des œuvres universitaires et, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, par le vice-recteur territorialement compétent.
L'aide à la mobilité est versée à compter du mois suivant celui où le demandeur a produit l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de sa demande. La mise en paiement est effectuée en début de mois.
Le montant de l'aide à la mobilité est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
Le décret entre en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2017-2018. 
Personnels
QUESTIONS COMMUNES
 Droit à la formation professionnelle tout au long de la vie – Création du compte personnel d'activité dans la fonction publique – Création du congé pour invalidité temporaire imputable au service – Accident de service et maladie professionnelle (définition) – Mi-temps thérapeutique – Reclassement Droit à la formation professionnelle tout au long de la vie – Création du compte personnel d'activité dans la fonction publique – Création du congé pour invalidité temporaire imputable au service – Accident de service et maladie professionnelle (définition) – Mi-temps thérapeutique – Reclassement
Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique
J.O.R.F. du 20 janvier 2017
Prise en application de l’article 44 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique prévoit pour les fonctionnaires et agents contractuels de droit public des trois fonctions publiques (fonction publique de l’État, territoriale et hospitalière) de nouvelles garanties en matière de formation professionnelle (I), d’une part, et de santé et sécurité au travail (II), d’autre part.
La présentation qui suit examine les nouvelles dispositions pour la fonction publique de l’État, étant précisé que des dispositions identiques sont également introduites pour la fonction publique territoriale et pour la fonction publique hospitalière.
I. De nouvelles garanties relatives au droit à la formation professionnelle dans la fonction publique
Le titre Ier de l’ordonnance du 19 janvier 2017, après avoir précisé l’objet du droit à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la fonction publique (A), étend le bénéfice du compte personnel d’activité à tous les agents publics (B).
A. Le droit à la formation professionnelle au sens du nouvel article 22 de la loi du 13 juillet 1983
L’article 1er de l’ordonnance du 19 janvier 2017, qui modifie l’article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, précise que le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie, reconnu aux fonctionnaires, a pour objet :
– de favoriser le développement professionnel et personnel des fonctionnaires,
– de faciliter leur parcours professionnel, leur mobilité et leur promotion ainsi que l'accès aux différents niveaux de qualification professionnelle existants,
– de permettre leur adaptation aux évolutions prévisibles des métiers,
– de concourir à l'égalité d'accès aux différents grades et emplois, en particulier entre les femmes et les hommes, et à la progression des personnes les moins qualifiées.
Dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 janvier 2017, cet article 22 abroge les dispositions relatives au droit individuel à la formation (DIF), mais reprend les dispositions selon lesquelles les fonctionnaires :
– peuvent être tenus de suivre des actions de formation dans les conditions fixées par les statuts particuliers,
– peuvent bénéficier de périodes de professionnalisation leur permettant soit d’exercer de nouvelles fonctions dans le corps ou cadre d’emplois dont ils relèvent, soit d’accéder à un autre corps ou cadre d’emplois.
Il prévoit, en outre, un conseil en évolution professionnelle permettant de faire bénéficier le fonctionnaire qui en fait la demande d’un accompagnement personnalisé pour mettre en œuvre son projet professionnel.
B. L’extension du compte personnel d’activité aux agents de la fonction publique
1. Définition du compte personnel d’activité
L’article 2 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 introduit un nouvel article 22 ter dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, pour créer le compte personnel d'activité dans la fonction publique, qui a pour objectifs de renforcer l'autonomie et la liberté d'action de son titulaire et de faciliter son évolution professionnelle. Ce compte est constitué de deux dispositifs :
– le compte personnel de formation,
– le compte d'engagement citoyen, dont les conditions sont fixées par le code du travail.
Le nouvel article 22 ter précise que le titulaire du compte personnel d’activité peut consulter les droits inscrits sur son compte grâce au service en ligne gratuit mentionné à l’article L. 5151-6 du code du travail et qu’il peut faire valoir auprès de toute personne publique ou privée qui l’emploie, selon les modalités du régime dont il relève au moment de sa demande, les droits qu’il a précédemment acquis, qui lui sont conservés jusqu’à leur utilisation ou la fermeture du compte.
L’entrée en vigueur des dispositions de l’article 22 ter nouveau de la loi du 13 juillet 1983 tel qu’issu de l’ordonnance du 19 janvier 2017 est subordonnée à la publication d’un décret qui en déterminera les conditions de mise en œuvre. Quant au système en ligne gratuit prévu par cet article, la date de son entrée en vigueur sera fixée par décret, sans pouvoir être postérieure au 1er janvier 2020 (cf. article 12 de l’ordonnance).
2. Définition et régime du compte personnel de formation
Aux termes du nouvel article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983, créé par l’article 3 de l’ordonnance, le compte personnel de formation a pour objectif de permettre au fonctionnaire d’accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle.
Cet article précise également :
– l’articulation du compte personnel de formation avec les autres dispositifs de formation (congé de formation professionnelle, congé pour validation des acquis de l'expérience et pour bilan de compétences, préparations aux examens et concours administratifs – cf. I de l’article 22 quater) ;
– les modalités de mobilisation des droits inscrits sur le compte (demande du fonctionnaire ; accord entre le fonctionnaire et son administration ; motivation de toute décision de refus opposée à une demande ; droit, éventuellement différé l’année suivant la demande, à utilisation du compte pour une formation relevant du socle de connaissances et de compétences mentionné à l’article L. 6121-2 du code du travail – cf. II de l’article 22 quater) ;
– les modalités d'alimentation du compte (à la fin de chaque année ; dans le cas général : vingt-quatre heures maximum par année de travail à temps plein jusqu’à l’acquisition d’un crédit de cent vingt heures, puis douze heures maximum par année dans la limite d’un plafond total de 150 heures maximum ; pour les fonctionnaires de catégorie C n’ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné par un titre ou diplôme classé au niveau V de qualification : quarante-huit heures maximum par année de travail à temps plein dans la limite d’un plafond total de 400 heures – cf. III de l’article 22 quater) ;
– un dispositif particulier en vue de prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions par le fonctionnaire : possibilité d’un crédit supplémentaire d’un maximum de 150 heures en complément des droits acquis (cf. IV de l’article 22 quater).
L’article 22 quater consacre également un principe de portabilité du compte personnel de formation en cas de changement d’employeur. Il prévoit ainsi que les droits acquis préalablement au recrutement dans la fonction publique au titre du compte personnel de formation ouvert selon les conditions prévues à l'article L. 6323-1 du code du travail sont conservés par l’agent et utilisés dans les conditions qu’il fixe pour les agents publics (cf. V de l’article 22 quater).
L’article 5 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 précise par ailleurs qu’une personne qui perd la qualité d’agent public peut utiliser les droits qu’elle a acquis en cette qualité au titre du compte personnel de formation auprès de tout nouvel employeur selon les modalités du régime dont elle relève au moment de la demande d'utilisation de son compte personnel de formation.
Là encore, les modalités d’application de l’article 22 quater nouveau sont renvoyées à un décret en Conseil d’État, à la publication duquel est par conséquent subordonnée l’entrée en vigueur de cet article.
Enfin, l’article 11 de l’ordonnance prévoit, à titre de disposition transitoire, que les agents publics conservent les heures qu’ils ont acquises au 31 décembre 2016 au titre du droit individuel à la formation et peuvent les utiliser pour bénéficier de formations dans les conditions prévues par l’article 3 de l’ordonnance pour les droits acquis au titre du compte personnel de formation, le calcul des droits ouverts au titre de ce dernier prenant pour sa part en compte les heures travaillées à compter du 1er janvier 2017.
C. L’application du nouveau dispositif aux agents non titulaires
Les dispositions des articles 22, 22 ter et 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 sont rendues applicables aux agents contractuels par l’article 4 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 qui modifie en ce sens l’article 32 de cette même loi.
II. De nouvelles garanties relatives à la santé et à la sécurité dans la fonction publique
Le titre II de l’ordonnance du 19 janvier 2017 renforce les garanties applicables aux agents publics en matière de prévention et d’accompagnement de l’inaptitude physique et améliore leurs droits pour faire face à des difficultés de santé (A). Il améliore également le régime des accidents de service et des maladies professionnelles qui leur est applicable en consacrant un régime d’imputabilité au service de certains accidents survenus dans le service et de certaines maladies professionnelles (B).
A. Le renforcement des garanties en matière de prévention et d’accompagnement de l’inaptitude physique
– D’une part, l’article 8 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 modifie l’article 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État pour simplifier et améliorer les conditions d’accès au temps partiel thérapeutique.
Ainsi, est supprimée la condition de six mois continus d'arrêt de travail à laquelle était subordonné, en cas de maladie d'origine non professionnelle, le bénéfice d’un temps partiel thérapeutique.
Par ailleurs, pour les maladies professionnelles comme pour les maladies qui ne sont pas d’origine professionnelle, l’autorisation de travail à temps partiel thérapeutique est désormais accordée lorsque l’avis du médecin traitant de l’agent et l’avis du médecin agréé par l’administration sont concordants : dorénavant, pour l’octroi d’un temps partiel thérapeutique, l'avis de l'instance médicale compétente (comité médical pour les maladies non professionnelles, ou commission de réforme pour les maladies professionnelles) n’est plus requis que dans les seuls cas où les avis du médecin traitant de l’agent et du médecin agréé par l'administration ne sont pas concordants.
– D’autre part, l’article 9 de l’ordonnance ajoute un dernier alinéa à l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 pour créer un droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale d’un an, assimilée à une période de service effectif, au bénéfice du fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions sans toutefois avoir été reconnu inapte définitivement à tout emploi public.
Ce dispositif, qui fait désormais partie intégrante de la procédure de reclassement professionnel, est mis en œuvre avec l’accord de l’agent. La période de préparation au reclassement pourra ainsi être mobilisée par les employeurs publics pour accompagner les agents devenu inaptes à leurs fonctions ou risquant de le devenir et dont les besoins de reconversion sont avérés.
Les modalités de mise en œuvre de cette période de préparation au reclassement seront précisées par décret en Conseil d’État.
B. Le renforcement des garanties relatives à la prise en charge du risque professionnel
1. La création du congé pour invalidité temporaire imputable au service
En son I, l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 introduit dans la loi du 13 juillet 1983 un nouvel article 21 bis qui crée un droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service pour tout fonctionnaire en activité dont l’incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service, chacune de ces notions étant définie par le même article 21 bis nouveau, en ses II, III et IV.
Le fonctionnaire bénéficiaire du congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.
La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
En conséquence de la création de ce nouveau congé, l’article 10 de l’ordonnance modifie, en son II, l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 pour y supprimer les dispositions relatives aux congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée reconnus imputables au service (maladie provenant d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions) : ainsi, le II de l’article 10, d’une part, modifie le deuxième alinéa du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 pour exclure explicitement du régime du congé de maladie ordinaire les maladies provenant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service et, d’autre part, supprime le deuxième alinéa du 4° de ce même article 34 (congé de longue durée imputable au service), puisque désormais, les maladies imputables au service ouvrent droit au nouveau dispositif du congé pour invalidité temporaire imputable au service prévu par l’article 21 bis nouveau de la loi du 13 juillet 1983.
Le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 créé par l’article 10 de l’ordonnance renvoie cependant à un décret en Conseil d’État les modalités d’application du congé pour invalidité temporaire imputable au service et ses effets sur la situation administrative du fonctionnaire, ainsi que la détermination des obligations auxquelles le fonctionnaire doit se soumettre, d'une part, pour pouvoir bénéficier de ce congé et, d'autre part, en vue du rétablissement de sa santé.
Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du décret définissant les modalités d’application du congé pour invalidité temporaire imputable au service que prévoit le VI de l’article 21 bis nouveau de la loi du 13 juillet 1983, et auquel est par conséquent subordonnée l’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif législatif, le régime des congés pour raisons de santé des fonctionnaires de l’État prévu par l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ne sera plus applicable aux agents dont l’incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service.
Le régime des congés de maladie et de longue maladie prévu au deuxième alinéa des 2° et 3° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 demeurera en revanche applicable au fonctionnaire dont l’incapacité de travail résulte d’une blessure ou d’une maladie contractée en dehors du service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans l’intérêt général, soit en exposant sa vie pour sauver celle d’une ou plusieurs personnes.
2. Un régime de présomption d’imputabilité au service pour les accidents de service et certaines maladies professionnelles contractées dans certaines conditions
– Le II de l’article 21 bis nouveau de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 janvier 2017 consacre au niveau législatif la présomption d’imputabilité au service, dégagée par la jurisprudence administrative (cf. C.E. Section, 16 juillet 2014, n° 361820, au Recueil Lebon), de tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu’il a lieu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui constitue le prolongement normal de ses fonctions, sous la seule réserve d’une faute personnelle du fonctionnaire ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service.
Quant à la précision selon laquelle la cause de l’accident est indifférente (« quelle qu’en soit la cause »), elle paraît avoir seulement pour objet de rappeler qu’une chute survenue dans le temps et le lieu du service, alors que l’agent exerce ses fonctions ou s’apprête à prendre ses fonctions, ne perd pas nécessairement la qualification d’« accident de service » quand bien même elle aurait pour origine une cause sans lien avec le service, comme un malaise (cf. C.E., 30 juin 1995, Caisse des dépôts et consignations, n° 124622, au Recueil Lebon ; C.E., 13 octobre 1997, n° 126362, aux tables du Recueil Lebon).
Il résulte de ce régime de présomption que seule une faute personnelle du fonctionnaire ou une circonstance particulière détachant l’accident du service peut permettre à l’administration d’écarter la présomption d’imputabilité applicable à l’accident survenu en service. En ce qui concerne la notion de « circonstance particulière de nature à détacher l’accident du service », la jurisprudence en matière d’accidents survenus en mission a eu l’occasion de la préciser : est ainsi qualifié d’« accident de service » un accident survenu en mission dans l’accomplissement d’un acte de la vie courante, sauf s’il a eu lieu lors d’une interruption de cette mission pour des motifs personnels (C.E. Section, 3 décembre 2004, n° 260786, au Recueil Lebon).
– Le III de l’article 21 bis nouveau de la loi du 13 juillet 1983 définit l’accident de trajet, auquel, à la différence du précédent, il n’applique pas le régime de la présomption d’imputabilité au service.
En effet, si l’accident de trajet dont est victime un fonctionnaire se définit comme celui qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière, étrangère notamment aux nécessités de la vie courante, est de nature à détacher l'accident du service, il appartient au fonctionnaire ou à ses ayants droit d’établir son imputabilité au service sauf lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer d’éléments suffisants.
Si la définition de l’accident de trajet ainsi retenue par la loi ne s’écarte pas de celle dégagée par la jurisprudence du Conseil d’État, elle lui refuse en revanche la présomption d’imputabilité au service que lui reconnaissait cette jurisprudence (cf. C.E. Section, 17 janvier 2014, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État c/ M. X, n° 352710, au Recueil Lebon).
– Le IV de l’article 21 bis nouveau de la loi du 13 juillet 1983 prévoit également un régime de présomption d’imputabilité au service pour certaines maladies uniquement, d’autres maladies en étant exclues.
Est désormais présumée imputable au service toute maladie figurant dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui a été contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La loi n’exclut toutefois pas l’imputabilité au service d’autres maladies, mais elles ne bénéficient pas de cette présomption d’imputabilité :
** ainsi, d’une part, une maladie figurant dans les tableaux de maladies professionnelles du code de la sécurité sociale précédemment mentionnés peut être reconnue imputable au service, quand bien même une ou plusieurs conditions mentionnées dans le tableau (conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux) ne sont pas remplies, mais il appartient alors au fonctionnaire victime ou à ses ayants droit d’apporter la preuve du lien de causalité directe entre l’exercice des fonctions et la maladie ;
** d’autre part, une maladie qui ne figure pas dans les tableaux de maladies professionnelles du code de la sécurité sociale précédemment mentionnés peut également être reconnue imputable au service lorsque, là encore, le fonctionnaire victime ou ses ayants droit apportent la preuve qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.
– Enfin, le V de l’article 21 bis nouveau de la loi du 13 juillet 1983 rappelle que l’employeur public est subrogé dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d’un accident provoqué par un tiers jusqu’à concurrence du montant des charges qu’il a supportées ou supporte du fait de cet accident et qu’il est admis à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées au fonctionnaire victime pendant la période d’indisponibilité de ce dernier par dérogation aux dispositions de l’ article 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques. 
QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE
 Recrutement et emploi des étudiants Recrutement et emploi des étudiants
Décret n° 2017-963 du 10 mai 2017 modifiant les dispositions du code de l’éducation relatives au recrutement et à l’emploi des étudiants
J.O.R.F. du 11 mai 2017
Ce décret du 10 mai 2017 modifie les dispositions du code de l’éducation relatives aux conditions de recrutement et d'emploi des étudiants dans les établissements publics d'enseignement supérieur en ouvrant la possibilité aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires de recruter des étudiants.
Le décret aménage également les conditions d'exercice du contrat, en permettant aux étudiants qui accompagnent des étudiants handicapés et qui suivent la même formation qu'eux d'exercer cette activité en même temps qu'ils suivent leurs enseignements.
Le décret modifie, en outre, l’article D. 811-4 du code de l’éducation pour préciser l’application des dispositions du nouvel article L. 611-9 du code de l'éducation, créé par l’article 29 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, aux contrats conclus avec les établissements d’enseignement supérieur et les CROUS, et permettre ainsi la validation au titre de leur formation universitaire des compétences, connaissances et aptitudes acquises par les étudiants dans le cadre de l’activité professionnelle exercée.
Enfin, le décret modifie l’article D. 811-8 pour prévoir qu’au cours d’une même année universitaire, un étudiant peut conclure plusieurs contrats avec un même établissement ou avec des établissements différents, et crée un article D.811-8-1 pour imposer aux établissements de procéder à une évaluation annuelle, quantitative et qualitative des contrats conclus avec les étudiants. 
Enseignants-chercheurs
 Dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs Dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs
Décret n° 2017-854 du 9 mai 2017 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences
J.O.R.F. du 10 mai 2017
Le décret n° 2017-854 du 9 mai 2017 modifie le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 à la fois pour rendre applicable aux corps des professeurs des universités et des maîtres de conférences le protocole « parcours professionnels, carrières et rémunérations », les dispositions modifiées à cet effet n’entrant en vigueur qu’au 1er septembre 2017, et pour modifier quelques-unes des dispositions statutaires propres à ces corps.
Le décret du 9 mai 2017 crée en particulier un nouveau chapitre IV intitulé « Accès aux zones à régime restrictif » afin de concilier les dispositions du statut des enseignants-chercheurs avec les dispositions de l’article R. 413-5-1 du code pénal.
Cet article prévoit en effet la création de zones à régime restrictif dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche dont le besoin de protection tient à l’impératif qui s’attache à empêcher que des éléments essentiels du potentiel scientifique ou technique de la Nation fassent l’objet d’une captation de nature à affaiblir les moyens de défense de l’État ou à compromettre sa sécurité, ou soient détournés à des fins de terrorisme ou de prolifération d’armes de destruction massive.
Cet article du code pénal prévoit ensuite que l’accès à une zone à régime restrictif pour y effectuer un stage, y préparer un doctorat, y participer à une activité de recherche, y suivre une formation, mais également pour y exercer une activité professionnelle est soumis à l’autorisation du chef d’établissement, donnée après avis favorable du ministre de tutelle.
Le nouvel article 20-4 prévoit donc que la nomination ou l’affectation d’un enseignant-chercheur dans un emploi impliquant l’exercice d’activités dans une zone à régime restrictif est subordonnée à l’existence préalable d’une autorisation d’accès. Il prévoit également que les candidats à un emploi d’enseignant-chercheur bénéficient d’une information adaptée quant à l’existence éventuelle d’une telle autorisation d’accès.
Par ailleurs, un article 20-3 est introduit dans le décret du 6 juin 1984 pour préciser que lorsque la commission de réforme départementale est appelée à connaître de la situation d’un enseignant-chercheur, ce dernier doit être représenté par deux enseignants-chercheurs de son établissement d’affectation appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps. Ces enseignants sont désignés par les enseignants-chercheurs et personnels assimilés siégeant au comité technique de l’établissement.
L’article 32 du décret du 6 juin 1984 est, pour sa part, modifié pour prévoir notamment que les maîtres de conférences stagiaires bénéficient pendant leur année de stage d’une formation leur permettant d’approfondir leurs compétences pédagogiques dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Au cours de cette période, ils sont déchargés d’un sixième de leur service d’enseignement et ne peuvent effectuer des enseignements complémentaires. Un nouvel article 32-1 leur permet de demander à bénéficier d’une formation complémentaire au cours des cinq années qui suivent leur titularisation.
Diverses mesures concernent le recrutement des enseignants-chercheurs. C’est ainsi, notamment, que l’article 43 du décret du 6 juin 1984 prévoit désormais que les candidats exerçant « ou ayant cessé d’exercer depuis moins de dix-huit mois » une fonction d'enseignant-chercheur d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir dans un établissement d'enseignement supérieur d'un État autre que la France sont dispensés de l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeurs.
L’article 46-1 est également modifié pour offrir aux maîtres de conférences ayant achevé depuis moins de cinq ans un mandat de vice-président dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel la possibilité de se présenter aux concours réservés dont, jusqu’ici, ne pouvaient bénéficier que les maîtres de conférences qui avaient achevé un mandat de président. 
Accès aux documents administratifs
COMMUNICATION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
 Traitement algorithmique – Décisions individuelles Traitement algorithmique – Décisions individuelles
Décret n° 2017-330 du 14 mars 2017 relatif aux droits des personnes faisant l’objet de décisions individuelles prises sur le fondement d’un traitement algorithmique
J.O.R.F. du 16 mars 2017
Ce décret du 14 mars 2017 précise les conditions d’application de l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration (C.R.P.A.), issu de l’article 4 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, qui ajoute une obligation à la charge de l’administration en prévoyant qu’une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique doit comporter une mention explicite en informant l’intéressé, lequel peut demander que lui soient communiquées les règles définissant ce traitement, ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre.
À cette fin, le décret insère deux nouveaux articles dans le C.R.P.A. :
1) l’article R. 311-3-1-1, qui vient préciser la notion de « mention explicite » : il prévoit que toute décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique doit indiquer la finalité du traitement, les modalités d’exercice du droit de l’intéressé d’obtenir la communication des règles définissant le traitement et des principales caractéristiques de sa mise en œuvre, ainsi que les modalités de saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) en cas de refus de communication ;
2) l’article R. 311-3-1-2, qui précise quant à lui les modalités de communication des règles définissant le traitement algorithmique. À la demande de toute personne faisant l’objet d’une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, l’administration a l’obligation de lui communiquer « sous une forme intelligible » les informations suivantes :
– le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ;
– les données traitées et leurs sources ;
– les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l’intéressé ;
– les opérations effectuées par le traitement.
Ces nouvelles dispositions rentreront en vigueur le 1er septembre 2017. 
|

 Jurisprudence
Jurisprudence

 Consultations
Consultations

 Le point sur
Le point sur

 ActualitÉs
ActualitÉs

 Jurisprudence
Jurisprudence

 Consultations
Consultations

 Le point sur
Le point sur

 ActualitÉs
ActualitÉs